"If we wish to stop the atrocities, we need merely to step away from the isolation. There is a whole world waiting for us, ready to welcome us home." Derrick Jensen
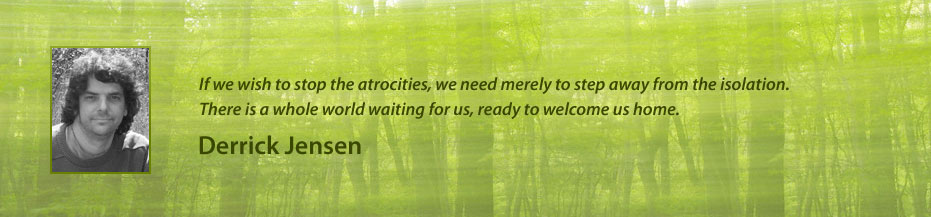
-
See the Archives
- March 2023
- September 2019
- August 2019
- March 2019
- October 2018
- September 2018
- August 2018
- July 2018
- June 2018
- May 2018
- April 2018
- March 2018
- February 2018
- January 2018
- December 2017
- November 2017
- October 2017
- September 2017
- August 2017
- July 2017
- May 2017
- April 2017
- March 2017
- February 2017
- January 2017
- December 2016
- October 2016
- September 2016
- August 2016
- March 2016
- January 2016
- December 2015
- November 2015
- August 2015
- July 2015
- June 2015
- March 2015
- February 2015
- January 2015
- November 2014
- October 2014
- August 2014
- May 2014
- April 2014
- March 2014
- January 2014
- December 2013
- November 2013
- October 2013
- September 2013
- July 2013
- June 2013
- May 2013
- March 2013
- January 2013
- September 2012
- July 2012
- May 2012
- February 2012
- January 2012
- December 2011
- September 2011
- August 2011
- July 2011
- May 2011
- March 2011
- February 2011
- January 2011
- December 2010
- November 2010
- September 2010
- July 2010
- June 2010
- May 2010
- March 2010
- January 2010
- December 2009
- November 2009
- October 2009
- September 2009
- July 2009
- May 2009
- February 2009
- January 2009
- November 2008
- September 2008
- August 2008
- June 2008
- February 2008
- December 2007
- November 2007
- October 2007
- June 2007
- May 2007
- April 2007
- March 2007
- January 2007
- November 2006
- October 2006
- September 2006
- August 2006
- July 2006
- June 2006
- May 2006
- January 2006
- September 2005
- July 2005
- April 2005
- December 2004
- September 2004
- July 2004
- May 2004
- March 2004
- February 2004
- November 2003
- October 2003
- July 2003
- June 2003
- May 2003
- March 2003
- February 2003
- November 2002
- July 2002
- June 2002
- May 2002
- March 2002
- February 2002
- December 2001
- October 2001
- August 2001
- July 2001
- April 2001
- March 2001
- February 2001
- December 2000
- November 2000
- October 2000
- September 2000
- July 2000
- June 2000
- May 2000
- April 2000
- March 2000
- January 2000
- December 1999
- November 1999
- September 1999
- August 1999
- March 1999
- October 1998
- September 1998
- August 1998
- May 1998
- November 1997
- July 1997
- April 1997
- January 1997
- October 1996
- May 1996
- April 1996
- October 1995
- March 1995
- April 1991
- Filter by Category
Catastrophe
June 15th, 2006L’homme moderne a la prétention de penser éveillé. Mais cette pensée éveillée nous a conduits par les corridors sinueux d’un cauchemar, où les miroirs de la raison multiplient les chambres de torture. Quand nous nous réveillerons, nous découvrirons peut-être que nous rêvions les yeux ouverts, et que les songes de la raison sont intolérables. Et alors, peut-être recommencerons-nous à rêver les yeux fermés.
Octavio Paz
Il est d’usage, lorsque l’on écrit, de garder pour soi ses postulats. On espère que les lecteurs se laissent porter par le récit et, transportés par les mots, qu’ils aboutissent finalement aux mêmes conclusions que l’auteur, sans s’apercevoir que, le plus souvent, le point de départ non spécifié est d’une importance bien plus cruciale pour parvenir à la conclusion que les arguments en eux-mêmes. Par exemple, vous entendez un expert demander, à la télévision : « Comment allons-nous garantir la croissance économique des États-Unis ? » Première prémisse : Nous souhaitons que l’économie américaine croisse. Seconde prémisse : Nous voulons que l’économie américaine existe. Troisième prémisse : Mais qui diable est donc ce nous ?
Je vais essayer de ne pas vous imposer sournoisement de prémisses. Je veux les exposer aussi clairement que possible, afin que vous puissiez les accepter ou les rejeter. L’une des raisons qui m’y pousse, c’est que les questions que j’explore au sujet de la civilisation sont les plus importantes que nous ayons jamais été contraints d’affronter, à la fois en tant que culture qu’en tant qu’individus. Je ne veux pas tricher. Je ne souhaite convaincre personne, ni vous, ni moi-même, de manière abusive (pas davantage, d’ailleurs, que je ne désire convaincre qui que ce soit), mais je cherche plutôt à nous aider à comprendre ce qu’il faut faire (ou pas) et comment (ou pourquoi pas).
J’essaierai de servir cet objectif de la façon la plus transparente — et honnête — possible.
Certaines des affirmations sur lesquelles ce livre s’appuie sont évidentes en elles-mêmes, certaines ont déjà été démontrées ailleurs, certaines seront développées ici. Bien évidemment, je ne peux pas répertorier l’intégralité de mes prémisses, puisque beaucoup d’entre elles me sont à moi-même inconnues, ou, plus fondamentalement, sont inhérentes à la langue anglaise, ou à l’écriture (les livres, par exemple, impliquent un début, un milieu et une fin). Quoi qu’il en soit, je ferai de mon mieux.
La première prémisse que je souhaite évoquer est tellement évidente que je suis embarrassé de devoir l’écrire ; c’est aussi ridicule que de devoir préciser que l’air pur ou l’eau potable sont des choses bonnes et nécessaires, et aussi irréfutable que la pollution de l’air et de l’eau que nous respirons et buvons. Mais notre capacité et notre propension à nous leurrer — ainsi, bien sûr, que la nécessité de cet aveuglement qui permet la propagation de cette culture — me poussent à être explicite. La première prémisse est : la civilisation n’est pas et ne sera jamais soutenable. D’autant moins la civilisation industrielle.
Il y a quelques années, j’ai eu une conversation intéressante, tandis que j’étais en voiture avec mon ami et camarade militant George Draffan. Il a influencé ma pensée plus que quiconque. C’était par une chaude journée à Spokane. Le trafic était lent. Une longue file de véhicules attendait au feu. Je lui ai demandé, « Si tu pouvais choisir de vivre à un niveau technologique donné, lequel choisirais-tu ? »
En plus d’être un ami et un activiste, George est aussi un râleur. Il était de cette humeur à ce moment-là. Il m’a répondu, « C’est une question stupide. On peut rêver de vivre d’une manière ou d’une autre, mais le seul niveau de technologie soutenable, c’est l’âge de pierre. Ce que nous expérimentons maintenant n’est qu’un tout petit écart de parcours — nous sommes l’une des six ou sept générations à avoir jamais eu à supporter le bruit atroce des moteurs à combustion interne (en particulier à deux-temps) — et nous retournerons finalement au mode de vie que les humains connurent pendant la plus grande partie de leur existence. Dans quelques centaines d’années tout au plus. La seule question est de savoir ce qui restera encore du monde à ce moment-là ».
Il a raison, évidemment. Inutile d’être un scientifique de génie pour comprendre que tout système social reposant sur l’usage de ressources non-renouvelables, par définition, n’est pas durable : d’ailleurs, tout le monde est en mesure de le comprendre sauf les scientifiques de génie. L’espoir de ceux qui souhaitent perpétuer cette culture réside dans ce que l’on appelle les « ressources de substitution » ; ainsi, lorsqu’une ressource est tarie, une autre la remplace (j’imagine qu’il y a au moins un autre espoir plus répandu encore, celui qu’en ignorant les conséquences de nos actions, on puisse les éviter). Évidemment, sur une planète finie, cela ne fait que repousser l’inévitable, en occultant les destructions causées entre-temps, et cela soulève la question de ce qu’il restera de vivant lorsque le dernier remplacement aura eu lieu. Question : lorsque le pétrole sera épuisé, quelle ressource lui sera substituée pour faire tourner l’économie industrielle ? Prémisses non mentionnées : a) des substituts de rendement équivalent existent ; b) nous voulons que l’économie industrielle continue à tourner ; c) la garder en fonctionnement a plus d’importance pour nous (ou plutôt pour ceux qui prennent les décisions) que les vies humaines et non-humaines anéanties par l’extraction, la transformation, et l’utilisation de cette ressource.
Pareillement, toute culture reposant sur une utilisation non-renouvelable de ressources renouvelables est tout aussi insoutenable : si, année après année, de moins en moins de saumons reparaissent, tôt ou tard, aucun ne reparaîtra. Si, année après année, de moins en moins de forêts anciennes se dressent, tôt ou tard, il n’y en aura plus aucune. D’aucuns disent que la substitution de ressources à celles épuisées sauvera la civilisation une journée de plus. Dans le meilleur des cas, cela ne fait que repousser l’échéance tout en infligeant davantage de dégâts à la planète. C’est ce que nous observons, par exemple, à travers l’effondrement des réserves halieutiques du monde, les unes après les autres : il y a longtemps que nous avons pêché les poissons les plus rentables économiquement ; désormais même les soi-disant « poissons de rebut » sont menacés. Ils disparaissent, engloutis par l’appétit littéralement insatiable de la civilisation.
Autrement dit, n’importe quel groupe d’êtres vivants (humains ou non-humains, végétal ou animal) qui prend plus de son environnement que ce qu’il donne en retour épuisera son environnement, après quoi il devra se déplacer, ou bien sa population s’effondrera (ce qui, d’ailleurs, est la preuve en une seule phrase que la notion de compétition ne guide pas la sélection naturelle : si vous surexploitez votre environnement, vous l’épuiserez et mourrez ; la seule façon se survivre sur le long terme est de donner davantage que vous ne prenez). Cette culture — la civilisation occidentale — a épuisé son environnement pendant six mille ans, en commençant par le Moyen-Orient, et elle s’est maintenant propagée sur l’ensemble de la planète. A votre avis, quelle autre motif aurait-elle de continuer son expansion ? Et pourquoi pensez-vous qu’elle a développé, en parallèle, une rhétorique — une série d’histoires qui nous enseignent comment vivre — rendant manifeste non seulement la nécessité mais le caractère désirable et même moral de l’expansion perpétuelle — nous poussant hardiment à nous rendre où nul homme n’était allé avant — à travers une prémisse tellement fondamentale qu’elle en est imperceptible ? Les villes, éléments caractéristiques de la civilisation, ont toujours été dépendantes du prélèvement des ressources des campagnes environnantes, ce qui signifie, d’une part, qu’aucune ville n’a jamais été ou ne sera jamais soutenable en elle-même, et que d’autre part, dans le but de continuer leur expansion perpétuelle, les villes devront continuellement étendre le territoire dont elles requièrent l’incessante surexploitation. Je suis certain que vous percevez les problèmes que cela pose et le dénouement à prévoir sur une planète finie. Si vous ne pouvez ou ne voulez pas voir ces problèmes, je ne peux que vous souhaiter bonne chance dans votre carrière en politique ou dans les affaires. Étant données les conséquences, notre refus collectif — étudié jusqu’à l’obsession — de reconnaître l’inéluctabilité de ce dénouement et d’agir en fonction est bien plus qu’étrange.
On peut également exprimer l’insoutenabilité de ce mode de vie en soulignant que le soleil constitue la seule vraie source d’énergie de la planète (l’énergie stockée dans le pétrole, par exemple, est venue du soleil il y a bien longtemps ; et j’exclus l’énergie nucléaire de toute considération ici car seul un fou fabriquerait et/ou raffinerait intentionnellement des matériaux qui seront mortellement toxiques pendant des dizaines de milliers d’années, particulièrement pour les usages frivoles, triviaux et mortifères auxquels est destinée l’électricité : pensez aux toits rétractables des stades, aux collisionneurs de particules, et aux canettes de bière en aluminium), tout mode de vie utilisant plus d’énergie que ce qui nous parvient du soleil à chaque instant ne durera pas, parce que l’énergie différée — celle contenue dans le pétrole que l’on peut brûler, dans les arbres, que l’on pourrait brûler (et pourquoi pas dans les corps humains que l’on pourrait brûler) — sera tôt ou tard épuisée. CQFD.
Je suis presque toujours surpris par le nombre de gens intelligents et sensés qui invoquent des moyens magiques dans le but de maintenir ce mode de vie déconnecté. Pas plus tard qu’hier, j’ai reçu un e-mail d’une femme très intelligente qui écrivait, « Je ne pense pas que l’on puisse retourner en arrière. Je ne crois pas au retour à la vie de chasseur-cueilleur. Mais est-il possible d’avancer dans un sens qui nous mènerait à nouveau vers la soutenabilité ? »
Cela témoigne du niveau du dysfonctionnement de la civilisation : de moins en moins de gens intègres croient que nous pouvons ou devrions continuer dans cette voie en raison des bons services qu’elle offre ; au lieu de cela, le plus commun des arguments en sa faveur (et c’est aussi vrai pour beaucoup de ses manifestations particulières, comme l’économie globale ou les hautes technologies) semble être que puisque nous sommes pris dedans, autant tirer partie de cette très mauvaise situation. « Nous en sommes là, nous avons perdu la soutenabilité et la santé, désormais nous n’avons plus d’autre choix que de continuer sur ce chemin auto-destructeur (et destructeur des autres) ». Comme si, sous prétexte que nous étions déjà montés à bord du train pour Treblinka, nous ferions alors aussi bien d’y rester pour la promenade. Peut-être que par chance ou par choix (celui de quelqu’un d’autre) nous finirons malgré tout par éviter les chambres à gaz.
Quoi qu’il en soit, la bonne nouvelle, c’est que nous n’avons pas besoin de « retourner en arrière », puisque les humains et leurs prédécesseurs immédiats dans l’évolution ont vécu de manière soutenable pendant un million d’années au minimum (retirez l’adjectif immédiats et nous pouvons revoir l’estimation en milliards). Ce n’est pas dans « la nature humaine » de détruire son milieu. Si c’était le cas, nous l’aurions fait depuis bien longtemps, et nous aurions disparus depuis. Ce n’est pas non plus la stupidité qui a empêché (et qui empêche) les non-civilisés d’orienter leurs vies de manière à détruire leur environnement, ou de développer des technologies (par exemple des raffineries, des réseaux électriques et des usines) qui facilitent cette entreprise. En réalité, si l’on essayait d’établir une comparaison inter-culturelle de l’intelligence, la préservation du milieu me semblerait être un facteur de premier plan. Quoi qu’il en soit, lorsque les civilisés sont arrivés en Amérique du Nord, le continent était riche de populations humaines et non-humaines, vivant en équilibre et de manière soutenable. J’en ai déjà parlé ailleurs, comme bien d’autres l’ont fait, notamment les Indiens eux-mêmes.
Nous n’avons pas fondamentalement changé en tant qu’espèce au cours de ces quelques derniers milliers d’années ; dès lors, depuis bien avant l’aube de la civilisation, chaque enfant qui naît est toujours un être humain avec le potentiel de devenir un adulte capable de vivre de manière soutenable dans un lieu déterminé. Il suffit de permettre à l’enfant de grandir dans une culture qui vit de manière soutenable, qui valorise et récompense la soutenabilité, dont les membres se racontent des histoires qui la renforce, et au sein de laquelle est formellement interdit le genre d’exploitation qui mènerait à l’insoutenabilité. C’est naturel. Voilà qui nous sommes.
Pour que nous continuions à « avancer », chaque enfant doit être façonné afin qu’il oublie ce qu’être humain signifie, et, à la place, qu’il apprenne ce qu’être civilisé signifie. Comme l’explique le psychiatre et philosophe R. D. Laing, « Dès la naissance, lorsque le bébé de l’âge de pierre se retrouve face à la mère du 20e siècle, il est soumis à ces forces violentes… comme l’ont été sa mère et son père, et leurs parents, et les parents de leurs parents. Ces forces se préoccupent principalement de détruire la plus grande part de son potentiel, et dans l’ensemble, cette entreprise est couronnée de succès. Lorsque ce nouvel être humain atteint l’âge de quinze ans, on se trouve face à un être qui nous ressemble, une créature à moitié folle, plus ou moins adaptée à un monde insensé. Il s’agit de la normalité de notre époque ».
L’idée que nous ne pouvons ni abandonner ni éliminer la civilisation, sous prétexte que ce serait revenir en arrière, pose un autre problème, en ceci qu’elle émerge de la croyance selon laquelle l’histoire est un concept naturel — comme l’eau qui coule vers l’aval, ou le printemps qui suit l’hiver — et le « progrès » social (y compris technologique) aussi inévitable que le fait de vieillir. Cependant, l’histoire est le produit d’une manière spécifique de voir le monde, une manière qui est également influencée, entre autres choses, par la dégradation de l’environnement.
J’étais souvent choqué par les cours d’histoire mondiale à l’école, qui semblaient presque bibliques dans leur manière de prétendre que le monde avait débuté il y a six mille ans. Bien sûr, les professeurs et les auteurs des livres évoquaient vaguement l’époque des dinosaures, puis avançaient rapidement — en une phrase ou deux, littéralement— en négligeant les dizaines ou centaines de milliers d’années de l’existence humaine formant la « préhistoire », ce qui leur permettait d’éviter d’aborder de tels sujets, manifestement morts. Ces quelques moments n’étaient toujours qu’un court prélude à la seule saga humaine ayant jamais réellement compté : la civilisation occidentale. De la même façon, on taillait des raccourcis dans les cultures qui avaient existé (ou existent toujours) parallèlement à la civilisation occidentale, tandis que d’autres civilisations telles que les Aztèques, les Incas, les Chinois, et ainsi de suite, n’avaient droit qu’à un signe de tête familier, et que les cultures ahistoriques n’étaient mentionnées qu’au moment où leurs membres étaient réduits en esclavage ou exterminés. Il a toujours été clair que l’action débutait réellement au Moyen-Orient avec « l’avènement » de la civilisation, qui s’était ensuite déplacée à travers le bassin méditerranéen, en Europe du Nord et de l’Ouest, avait navigué sur le bleu de l’océan avec Christophe Colomb et son équipage, et qui brillait désormais entre les deux villes frappées par les attaques du 11 septembre 2001 : New-York et Washington DC (et dans une moindre mesure, Tinseltown [Hollywood]). Tout autre chose, personne, et lieu n’a d’intérêt que s’il est lié à cette histoire principale.
Ce qui m’exaspérait, ce n’était pas seulement le narcissisme et l’arrogance manifestes de reléguer toutes ces autres histoires à la périphérie (j’aimerais parler de racisme autant que d’arrogance, mais les indigènes blancs d’Europe sont écartés de ces histoires aussi nettement que les autres), ou la stupidité et l’insoutenabilité également remarquables de ne pas faire de l’environnement la figure centrale de son histoire, c’était le langage en lui-même. L’histoire, m’a-t-on répété, en cours et dans les livres, a débuté il y a six mille ans. Avant ça, il n’y avait pas d’histoire. C’était la préhistoire. Rien de très intéressant ne s’est passé pendant cette longue et sombre période où les gens grognaient dans des cavernes (faisons fi du fait que les langues indigènes encore existantes sont souvent plus riches, plus subtiles et plus complexes que l’anglais).
Pourtant, l’histoire a véritablement commencé il y a six mille ans. Avant cela, il y avait des histoires personnelles, mais il n’y avait pas d’histoires sociales notables dans le sens que nous lui donnons, en particulier parce que les cultures étaient cycliques (basées sur les cycles de la nature) et pas linéaires (basées sur les changements apportés par tel groupe social sur le monde qui l’entoure).
Je dois admettre que je n’aime toujours pas le mot préhistoire, car il confère à l’histoire ce caractère inévitable qui ne lui sied pas. En vérité, l’histoire n’avait rien d’inéluctable. Je ne suis pas simplement en train de dire que chaque histoire particulière n’est pas inévitable, mais plutôt que l’histoire en elle-même — l’existence de toute histoire sociale quelle qu’elle soit — n’a pas toujours été inévitable. Elle est inévitable pour le moment, mais il fut un temps où elle n’existait pas, et viendra le jour où elle cessera d’exister.
L’histoire repose sur au moins deux aspects, le premier est physique, le second, perceptuel. Comme toujours, ces deux aspects sont étroitement liés. En ce qui concerne le premier, l’histoire est marquée par le changement. L’histoire d’un individu peut être perçue comme une série d’accueils et de salutations, une croissance de la stature physique et des capacités, suivie par une diminution, un échange progressif de ces capacités de mémoire, d’expérience, et de sagesse. Des éléments de mon histoire. Je suis allé à l’université. Je pratiquais le saut en hauteur. Je me souviens de la sensation d’une douceur mystérieuse et érotique au moment de passer la barre, placée plus haute que ma tête. J’ai perdu ma souplesse en approchant la trentaine. Je courais encore vite, et lorsque je frappais une balle chopée vers l’arrêt-court, je devançais le lancer à chaque fois. Au cours de ma trentaine, l’arthrite m’a fait perdre ma rapidité, et maintenant je cours comme un entraîneur de lanceur, ou comme un figurant dans un film d’Akira Kurosawa. Il y a vingt ans, j’étais ingénieur. Il y a dix-huit ans, apiculteur. Il y a seize ans, je suis devenu activiste environnemental. En ce moment, j’écris un livre sur le problème de la civilisation. Je ne sais pas de quoi la suite de mon histoire sera faite.
Les histoires sociales sont également marquées par le changement. La déforestation du Moyen-Orient pour construire les premières villes. Les premières lois écrites de la civilisation, qui concernaient la propriété des humains et les esclaves non-humains. La fabrication du bronze, puis du fer, les minerais extraits par les esclaves, les métaux utilisés pour la conquête. Les premiers empires. La Grèce et ses tentatives de s’arroger le contrôle du monde. Rome et ses tentatives. La conquête de l’Europe. La conquête de l’Afrique. La conquête des Amériques. La conquête de l’Australie, de l’Inde et d’une grande partie de l’Asie. La déforestation de la planète.
Comme dans le cas de ma propre histoire, je ne sais pas de quoi l’avenir de l’histoire de notre société, ou de la terre sous ses pieds, sera fait. Je ne sais pas quand le barrage de Grand Coulee s’effondrera, et si les saumons seront toujours là pour réintégrer le haut Columbia. Je ne sais pas quand le fleuve Colorado atteindra à nouveau la mer, ou si la civilisation se sera effondrée avant que les grizzlys ne s’éteignent, ou les chiens de prairie, les gorilles, les thons, les grands requins blancs, les tortues de mer, les chimpanzés, les orang-outans, les chouettes tachetées, les grenouilles à pattes rouges de Californie, les salamandres tigrées, les tigres, les pandas, les koalas, les ormeaux, et bien d’autres espèces au bord de l’extinction.
L’important est de comprendre que l’histoire est marquée par le changement. Pas de changement, pas d’histoire.
Et un jour, l’histoire s’arrêtera. Lorsque le dernier morceau de fer rouillé du dernier gratte-ciel sera parti en poussière, quand finalement la terre et les humains sur la terre (en imaginant que nous survivions) auront trouvé un nouvel équilibre dynamique, il n’y aura plus aucune histoire. Les peuples vivront à nouveau dans les cycles de la terre, les cycles du soleil et de la lune, les saisons. Et aussi dans de plus longs cycles, celui des poissons qui glissent vers la mer puis remontent les rivières, emplis de vie nouvelle, celui des insectes qui dorment pendant des années pour se réveiller par une chaude après-midi d’été, celui des martres qui ne migrent massivement qu’une fois en plusieurs générations humaines, celui de l’augmentation puis du déclin des populations de lièvres d’Amérique et des lynx qui les mangent. Et des cycles encore plus longs, la naissance, la croissance, la mort et la décomposition des grands arbres, l’oscillation des parcours des rivières, l’ascension et la chute des montagnes. Tous ces cycles, ces cercles grands et petits.
Il s’agit de l’histoire d’une perspective écologique. D’un point de vue social et perceptuel, l’histoire a commencé quand certains groupes ou certaines classes, pour quelque raison, ont acquis le pouvoir de raconter ce qui se passait. Monopoliser l’histoire leur a permis d’instaurer une vision du monde à laquelle ils pouvaient ensuite faire adhérer d’autres gens. L’histoire est toujours racontée par les personnes qui sont en situation de contrôle. Les classes inférieures — et les autres espèces — peuvent souscrire ou non à la version académique des faits, présentée par les classes supérieures ; mais globalement, la plupart d’entre nous l’acceptons.
Cette acceptation engendre une série de conséquences perceptuelles, dont l’une, et pas des moindres, est l’incapacité de s’imaginer vivre de manière ahistorique, c’est-à-dire soutenablement — puisqu’un mode de vie soutenable ne serait évidemment pas défini par des changements dans le paysage plus vaste. Autrement dit, penser que l’histoire est inévitable ou naturelle, c’est rendre impensable l’idée qu’un « retour » à une vie non-industrialisée, et bien sûr non-civilisée, est possible, et c’est rendre inconcevable que l’un ou l’autre de ces choix n’est pas du tout, au sens plus large, un retour en arrière. Percevoir l’histoire comme inévitable, c’est garantir l’impossibilité de la soutenabilité. L’inverse est également vrai. Si nous parvenons à nous libérer de la perspective historique qui nous tient captifs afin de retourner aux schémas cycliques qui caractérisent le monde naturel — y compris les communautés humaines naturelles — nous découvrirons que les notions de marche en avant ou de retour en arrière perdront aussi leur prévalence. A ce moment, nous pourrons à nouveau vivre, simplement. Nous apprendrons à ne pas laisser ces marques sur la terre qui engendrent l’histoire, ces marques de dégradation environnementale, et nous pourrons enfin pousser un grand soupir de soulagement avec le reste du monde.
***
Il y a quelques années, j’ai eu une conversation intéressante avec George Draffan. Nous débattions autour de la civilisation, du pouvoir, de l’histoire, du discours public, de la propagande, et nous nous demandions pourquoi et comment nous acceptons tous ce système insoutenable dans lequel nous vivons. George m’a confié qu’il aimait beaucoup le modèle social et politique appelé « les trois facettes du pouvoir » : « La première facette est le mythe de la démocratie américaine, qui affirme que chaque individu a un pouvoir égal, et que la société, ou la politique, est simplement l’échange mutuel de différents groupes d’intérêts qui se réunissent et participent, où l’emportent les meilleures idées et les participants les plus actifs. Cette facette considère grosso-modo que ceux qui perdent sont des fainéants. La seconde facette admet que c’est plus complexe que cela, que certains groupes ont plus de pouvoir que d’autres, et qu’ils contrôlent en réalité l’agenda politique, de manière à ce que certains sujets, comme la distribution de la propriété, ne soient jamais abordés. La troisième facette du pouvoir se met en marche lorsque nous ne remarquons plus que certains sujets ne sont jamais à l’ordre du jour, et commençons à penser que l’inégalité dans le pouvoir, la famine, et certaines décisions économiques et sociales ne sont pas des décisions, mais seulement ‘les choses telles qu’elles sont’. Dès lors, même les plus démunis perçoivent l’injustice sociale comme étant l’ordre naturel ». Il a marqué une pause, puis a prononcé ces mots qui me hantent depuis : « La conspiration est inutile quand tout le monde pense la même chose ».
***
George a également ajouté : « Les trois facettes du pouvoir ont été développées comme des descriptions contradictoires de la réalité, mais je commence à les envisager comme une progression dans le temps, comme l’histoire de notre histoire.
Il fut un temps où nous étions égaux. Les structures sociales de beaucoup de cultures indigènes ont été mises en place pour garantir la fluidité du pouvoir. Mais dans certaines cultures, lorsque le pouvoir s’est centralisé, les puissants ont créé un discours — à travers la religion, la philosophie, la science ou l’économie — qui a rationalisé l’injustice et l’a institutionnalisée dans la perception d’un groupe. Au début, les plus faibles n’ont sûrement pas adhéré à ce discours, mais désormais, plusieurs milliers d’années plus tard, nous nous sommes tous plus ou moins faits leurrer et nous croyons que ces différences de pouvoir sont naturelles. Certains d’entre nous voudraient changer un peu l’agenda politique, mais sans qu’il y ait une compréhension globale de la matrice. Le pouvoir, comme la propriété, comme la terre et l’eau, a été privatisé et concentré. Et c’est le cas depuis si longtemps, et nous y croyons à un tel point, que nous imaginons que c’est dans l’ordre naturel des choses ».
***
Ça ne l’est pas.
***
Aujourd’hui, je suis tombé sur un article dans le magazine Nature, intitulé « Des changements catastrophiques dans les écosystèmes ». La pensée scientifique conventionnelle, semble-t-il, a généralement considéré que les écosystèmes — les communautés naturelles comme les lacs, les océans, les récifs coralliens, les forêts, des déserts, et ainsi de suite — répondaient de manière lente et continue au changement climatique, à la pollution des nutriments, à la dégradation des milieux, et aux nombreux autres impacts environnementaux de la civilisation industrielle. A l’inverse, une nouvelle étude suggère que de tels facteurs de stress peuvent engendrer des modifications, presque du jour au lendemain, de conditions apparemment stables vers un état très différent et appauvri. L’auteur principal de cette étude, Marten Scheffer, un environnementaliste à l’Université de Wageningen aux Pays-Bas, déclare que : « Les modèles l’avaient prévu, mais c’est seulement depuis quelques années qu’ont été rassemblées suffisamment de preuves nous indiquant que la résilience de beaucoup d’écosystèmes importants a été tellement sapée que la plus petite perturbation peut provoquer leur effondrement ».
C’est assez effrayant. Un des co-auteurs de l’étude, Jonathan Foley, un climatologue de l’Université de Wisconsin-Madison, ajoute que : « Lorsque nous abordons des questions relatives à la déforestation, aux espèces menacées, ou au changement climatique, nous travaillons avec la prémisse selon laquelle une once de pollution équivaut à une once de dégât. Il se trouve que cette assertion est complètement erronée. Les écosystèmes peuvent supporter d’être exposés à la pollution ou au changement climatique pendant des années sans montrer le moindre changement, et soudainement basculer dans un état complètement différent, sans avertissement ou presque ».
Par exemple, il y a six mille ans, de grandes étendues de ce qui est maintenant le désert du Sahara étaient humides, et l’on y trouvait des lacs et des marais regorgeant de crocodiles, d’hippopotames et de poissons. Foley poursuit : « Les lignes des indices géologiques et les preuves données par les modèles numériques montrent que cette zone plutôt humide est subitement devenue une zone plutôt sèche. La nature n’est pas linéaire. Parfois vous pouvez contraindre un système et le contraindre encore, et finalement, vous poserez le brin de paille qui brise le dos du chameau ». [L’expression anglaise « to break the camel’s back » correspond en français à « la goutte d’eau qui fait déborder le vase », cependant, nous avons choisi de traduire littéralement l’anglais étant donné que l’analogie, dans ce contexte, est plus parlante, NdT].
Souvent, une fois le dos du chameau cassé, il ne peut pas guérir ou ne recouvrera pas son état originel.
Un autre co-auteur, le limnologiste Stephen Carpenter, ancien président de la Société américaine d’écologie, souligne que cette compréhension — de la nature discontinue du changement écologique — commence à se répandre dans la communauté scientifique, et ajoute : « Nous réalisons qu’il y a un schéma commun que nous retrouvons dans les écosystèmes autour du monde. Des changements graduels de vulnérabilité s’accumulent, et finalement vous avez un impact sur le système, une inondation ou une sécheresse, et boum ! vous basculez dans un autre régime. Cela devient un effondrement autonome ».
Après avoir lu l’article, j’ai reçu un appel d’une amie, Roianne Ahn, une femme assez intelligente et tenace pour qu’un doctorat en psychologie ne voile pas sa perception de la pensée et des actions des gens. « Cela m’étonnera toujours », m’a-t-elle dit, « qu’il faille des experts pour nous convaincre de ce que l’on sait déjà ».
Ce n’était pas la réponse à laquelle je m’attendais.
« C’est l’un de mes rôles en tant que thérapeute. J’écoute et renvoie simplement aux patients ce qu’ils savent déjà mais ne parviennent pas à croire faute de confiance en eux, jusqu’à ce qu’il l’entendent de la bouche d’un expert », a-t-elle ajouté.
« Penses-tu que les gens écouteront ces scientifiques ? »
« Cela dépend de leur niveau de déni. Mais finalement, ce qu’ils décrivent n’est pas extrêmement surprenant. C’est ce qui arrive lorsqu’une personne est soumise au stress : elle peut seulement le supporter jusqu’à un certain point avant de s’effondrer. C’est ce qui arrive dans les relations. Cela arrive dans des familles. Cela arrive aux communautés. Naturellement, c’est également vrai dans ce contexte plus large ».
« Que veux-tu dire ? »
« Nous travaillons aussi dur que possible, nous nous dépassons, même, pour maintenir une stabilité, et lorsque la pression augmente trop, quelque chose doit lâcher. Nous nous effondrons. Parfois c’est une bonne chose, parfois non ».
Il y eut un silence pendant lequel j’ai réfléchi au fait que certains effondrements ne sont pas nécessaires — celui d’un prisonnier sous la torture, la destruction systématique de l’estime de soi sous le régime écrasant d’un parent ou d’un partenaire abusif, l’apocalypse écologique actuelle — tandis que d’autres peuvent permettre une guérison.
« Les raisons pour lesquelles les gens essaient de maintenir des structures saines qui les rendent heureux paraissent évidentes. En revanche, il n’est pas toujours aisé de comprendre pourquoi nous, y compris moi-même, semblons travailler si dur pour maintenir des structures et des systèmes qui nous rendent misérables. La notion selon laquelle beaucoup de toxicomanes ont besoin de toucher le fond avant de changer, même quand leur addiction est en train de les tuer, nous est tous familière », a-t-elle poursuivi.
« Quand penses-tu que cette culture va changer ? », lui ai-je demandé.
« Cette culture est clairement accro à la civilisation ; je pense donc que l’on peut répondre par une autre question : est-elle encore loin de toucher le fond ? »
***
J’ai raconté tout cela à une autre amie. Il était tard. Dehors, le vent soufflait. L’ordinateur était éteint. On entendait les rafales. Cette amie, une excellente penseuse et auteure, qui avait longtemps habité à New-York, était non seulement relativement attachée à cette grande ville, mais également aux villes en général. Elle était à la fois sensible et exaspérée par les propos que je venais de tenir. Après des heures de discussion, elle m’a posé une question, assez calmement : « De quel droit penses-tu pouvoir dire aux gens qu’ils ne peuvent pas vivre en ville ? »
« Aucun. Je me fiche totalement de savoir où vivent les gens. Mais les habitants des villes n’ont aucun droit de demander — et encore moins de voler — les ressources de tous les autres ».
« Quel problème cela te pose si les citadins les achètent ? »
« Les ressources ou les gens ? » Je me souvenais de la citation de Henry Adams : « Nous n’avons qu’un seul système, et dans ce système, la seule question est le prix auquel le prolétariat s’achète et se vend, le pain et les jeux ».
Ma plaisanterie ne l’a pas fait rire. Elle ne l’a pas trouvée drôle. Moi non plus, mais sans doute pour une raison différente.
« Les acheter avec quoi ? », lui ai-je demandé
« Ils nous donnent de la nourriture, nous leur donnons de la culture. Ce n’est pas comme ça que cela fonctionne ? »
D’accord, me suis-je dit, elle suit la ligne de pensée de Mumford. « Et si les gens de la campagne n’aiment pas l’opéra, ou Oprah, au demeurant ? »
« Ce n’est pas juste l’opéra. La bonne nourriture, les bons livres, les idées, tout le ferment culturel ».
« Et si ces personnes aiment leur propre nourriture, leurs propres idées, leur propre culture ? »
« Ils auront besoin de notre protection ».
« Pour les protéger de qui ? »
« Des groupes de maraudeurs itinérants. Des bandits qui déroberont leur nourriture ».
« Et si les seuls maraudeurs sont les habitants des villes ? »
Elle a hésité avant de rétorquer, « Des biens manufacturés, alors. Grâces aux économies d’échelle, les habitants des villes peuvent importer des matières premières en provenance de la campagne, les transformer en objets à l’usage des gens, et leur vendre en retour ». Elle avait un diplôme en économie.
« Et si les habitants des campagnes ne veulent pas non plus d’objets manufacturés ? »
« Alors la médecine moderne ».
« Et s’ils n’en veulent pas ? Je connais beaucoup d’Indiens qui refusent encore à ce jour la médecine occidentale ».
Elle a ri, et a ironisé, « Alors, allons dans le sens opposé : tout le monde veut des Big Macs ».
J’ai hoché la tête, et plus ou moins ignoré sa plaisanterie, comme elle avait ignoré la mienne, peut-être pour la même raison. « Les gens ne veulent ce genre de chose qu’après que leurs propres cultures ont été détruites ».
« Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de les détruire. Il vaut mieux les convaincre. La modernité est une bonne chose. Le développement est une bonne chose. La technologie est une bonne chose. Le choix des consommateurs est une bonne chose. A quoi sert à la publicité, à ton avis ? »
Peut-être qu’Henry Adams et le satire romain Juvenal auraient dû faire mention de la publicité autant que du pain et des jeux. Et peut-être auraient-ils aussi dû évoquer l’importance des définitions de dictionnaires dans le maintien de l’ordre. J’ai tenu ferme. « Les cultures intactes n’ouvrent généralement leurs portes aux biens de consommation que sous la menace armée. Bien sûr, ils pourraient choisir ce qui leur plaît, mais ce ne serait pas suffisant pour contrebalancer la perte de leurs ressources. Pense à ce qu’ont engendré l’ALENA et l’AGETAC pour les pauvres du Tiers-Monde, ou ceux des États-Unis. Pense à Perry et à l’ouverture du Japon, ou aux guerres de l’opium, ou… »
« J’ai saisi ton point de vue », m’a-t-elle interrompu. Elle a réfléchi un moment. « Donnons-leur de l’argent, plutôt que des objets manufacturés. Un prix honnête. Sans les escroquer. Ils pourront acheter ce qu’ils veulent avec tout leur argent, ou plutôt notre argent ».
« Et s’ils ne veulent pas d’argent ? S’ils préfèrent avoir accès à leurs ressources ? S’ils ne souhaitent pas les vendre parce qu’ils en ont eux-mêmes besoin ? Si l’ensemble de leur mode de vie dépend de ces ressources, et qu’ils préfèrent leur mode de vie — par exemple la cueillette et la chasse — à l’argent ? Ou s’ils ne veulent pas vendre parce qu’ils ne croient pas à l’achat et à la vente ? S’ils ne croient pas du tout aux transactions commerciales ? Ou, plus encore, s’ils ne croient pas au concept de ressources ? »
« Ils ne croient pas aux arbres ? Ils ne croient pas à l’existence des poissons ? Qu’imagines-tu qu’ils attrapent lorsqu’ils vont pêcher ? Qu’est-ce que tu racontes ? », s’est-elle énervée.
« Ils croient aux arbres et aux poissons. Seulement, ce ne sont pas des ressources ».
« Qu’est-ce que c’est, alors ? »
« D’autres êtres. Tu peux les tuer pour manger. Cela fait partie de la relation. Mais tu ne peux pas les vendre ».
« Comme pensaient les Indiens », a-t-elle réalisé.
« Comme ils le pensent toujours. Nombre de ceux qui vivent traditionnellement. Et les villes sont désormais si grandes — la mentalité des villes s’est étendue pour intégrer l’ensemble de la culture de consommation — que les gens des campagnes ne peuvent certainement pas tuer suffisamment pour nourrir la ville sans nuire à leur propre territoire. Cela n’a jamais été possible, par définition. Ce qui nous renvoie à la question : que se passe-t-il s’ils ne veulent pas vendre ? Est-ce que les citadins ont le droit de se saisir des ressources malgré tout ? »
« Comment feront-ils pour manger, autrement ? »
Nous entendions le vent au dehors, et la pluie commençait à battre sur les fenêtres. La pluie tombe souvent horizontalement ici à Crescent City, ou Tu’nes [nom indien du lieu, NdT].
« Si j’étais responsable d’une ville, et que mes concitoyens — mes concitoyens, c’est une expression intéressante, comme si je les possédais — mourraient de faim, je prendrais la nourriture de force », a-t-elle avoué.
Encore le vent, encore la pluie.« Et si tu as besoin d’esclaves pour faire tourner tes industries ? Tu les prendras aussi ? Et si tu n’as pas juste besoin de nourriture et d’esclaves, mais aussi de pétrole, le sang de ton économie, et de métal, ses os ? Si tu as besoin de tout ce qui se trouve sous le soleil ? Tu vas tout prendre ? », ai-je continué.
« Si j’en ai besoin… »
« Ou si tu as l’impression que tu en as besoin… », l’ai-je coupé.
Cela n’a pas eu l’air de la déranger. « Oui », a-t-elle acquiescé, dans ses pensées. Je pouvais la voir changer d’avis. « Et il y a le territoire. Les villes endommagent le territoire qu’elles occupent », a-t-elle observé, après un long silence.
J’ai pensé aux dallages et à l’asphalte. A l’acier. Aux gratte-ciels. J’ai pensé à un chêne vieux de cinq cents ans que j’avais vu à New-York, sur une pente qui surplombait le fleuve Hudson. J’ai pensé à tout ce qu’il avait vécu. Lorsqu’il était un gland, il était tombé dans une forêt ancienne — mais à l’époque il n’y avait aucune raison de qualifier ces forêts d’anciennes, ni de les appeler autrement que maison. Il avait germé dans cette communauté hétérogène, avait vu les saumons remonter le fleuve Hudson, tellement gros qu’ils pouvaient emporter les filets de ceux qui les attrapaient ; il avait été témoin de communautés humaines vivant dans ces forêts, des humains qui ne détruisaient pas les forêts mais au contraire les renforçaient par leur simple présence, par ce qu’ils donnaient à leur maison en retour. Il avait assisté à l’arrivée de la civilisation, à la construction d’un village, d’une cité, d’une métropole, et ensuite, comme l’a écrit Mumford, la « Parasitopole se transforme en Patholopole, la cité des désordres mentaux, moraux et physiques, pour terminer finalement en Nécropole, la cité des morts ». Au fur et à mesure, l’arbre a dit adieu au bison des bois, à la tourte voyageuse, au courlis esquimau, au grand châtaignier d’Amérique, au glouton qui longeait les rives de l’Hudson. Il a dit adieu (au moins pour un temps) aux modes de vie humains traditionnels. Il a dit adieu aux arbres du voisinage, à la forêt où il avait vu le jour. Il a observé les milliards de tonnes de béton se répandre, le surgissement d’inflexibles structures d’acier et d’édifices de briques couronnés de barbelés.
Malheureusement, il n’a pas vécu assez longtemps pour assister à l’effondrement de tout cela. J’ai appris l’an dernier que l’arbre n’était plus là. Il a été coupé par un propriétaire inquiet que ses branches ne tombent sur le toit de sa maison. Les écologistes — faisant ce qu’il semble que nous fassions le mieux — se sont recueillis sur sa souche.
Je lui ai raconté cette histoire.
« Merde… Je comprends ». Elle a hoché la tête. Une mèche de ses cheveux châtains a couvert son œil. Elle a fait la moue, comme souvent quand elle réfléchit. Finalement, elle a juré, « Nom d’un chien ». Puis elle a souri, imperceptiblement, et je voyais à ses yeux qu’elle était fatiguée. Soudain elle a conclu, « Tu sais, si nous allons faire tant de dégâts, le moins que l’on puisse faire c’est de dire la vérité ».
Traduction : Jessica Aubin
Filed in Français