"If we wish to stop the atrocities, we need merely to step away from the isolation. There is a whole world waiting for us, ready to welcome us home." Derrick Jensen
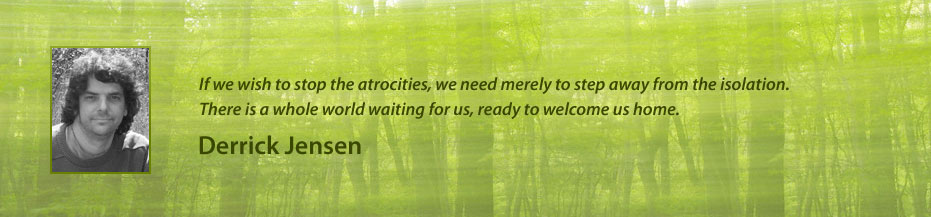
-
See the Archives
- March 2023
- September 2019
- August 2019
- March 2019
- October 2018
- September 2018
- August 2018
- July 2018
- June 2018
- May 2018
- April 2018
- March 2018
- February 2018
- January 2018
- December 2017
- November 2017
- October 2017
- September 2017
- August 2017
- July 2017
- May 2017
- April 2017
- March 2017
- February 2017
- January 2017
- December 2016
- October 2016
- September 2016
- August 2016
- March 2016
- January 2016
- December 2015
- November 2015
- August 2015
- July 2015
- June 2015
- March 2015
- February 2015
- January 2015
- November 2014
- October 2014
- August 2014
- May 2014
- April 2014
- March 2014
- January 2014
- December 2013
- November 2013
- October 2013
- September 2013
- July 2013
- June 2013
- May 2013
- March 2013
- January 2013
- September 2012
- July 2012
- May 2012
- February 2012
- January 2012
- December 2011
- September 2011
- August 2011
- July 2011
- May 2011
- March 2011
- February 2011
- January 2011
- December 2010
- November 2010
- September 2010
- July 2010
- June 2010
- May 2010
- March 2010
- January 2010
- December 2009
- November 2009
- October 2009
- September 2009
- July 2009
- May 2009
- February 2009
- January 2009
- November 2008
- September 2008
- August 2008
- June 2008
- February 2008
- December 2007
- November 2007
- October 2007
- June 2007
- May 2007
- April 2007
- March 2007
- January 2007
- November 2006
- October 2006
- September 2006
- August 2006
- July 2006
- June 2006
- May 2006
- January 2006
- September 2005
- July 2005
- April 2005
- December 2004
- September 2004
- July 2004
- May 2004
- March 2004
- February 2004
- November 2003
- October 2003
- July 2003
- June 2003
- May 2003
- March 2003
- February 2003
- November 2002
- July 2002
- June 2002
- May 2002
- March 2002
- February 2002
- December 2001
- October 2001
- August 2001
- July 2001
- April 2001
- March 2001
- February 2001
- December 2000
- November 2000
- October 2000
- September 2000
- July 2000
- June 2000
- May 2000
- April 2000
- March 2000
- January 2000
- December 1999
- November 1999
- September 1999
- August 1999
- March 1999
- October 1998
- September 1998
- August 1998
- May 1998
- November 1997
- July 1997
- April 1997
- January 1997
- October 1996
- May 1996
- April 1996
- October 1995
- March 1995
- April 1991
- Filter by Category
Le monde réel
January 1st, 2009Que devrions-nous faire, ou ferions-nous — ou faisons-nous —, vivant au sein de cette culture aliénée, et détruisant la Terre, si (ou lorsque) nous réalisions que ce monde se porterait mieux si nous n’étions jamais nés, ou si, étant nés, nous venions à mourir ?
Pour l’instant, du moins, je remarque plusieurs options pour lesquelles beaucoup de gens optent.
La première option, celle que choisit la quasi-totalité des membres de cette culture, c’est de faire tout ce que nous pouvons, à l’aide de tentatives de plus en plus effrénées et désespérées, pour maintenir cette réalisation au niveau de l’inconscient et l’empêcher d’atteindre le conscient. D’où les jet-skis et les véhicules-tous-terrains, d’où Disneyland, Disneyworld, le Futuroscope et le Parc Astérix. D’où la plongée sous-marine et le rafting en eaux-vives. D’où l’existence de centaines et centaines de chaînes de télévision, avec des films et d’autres films et toujours plus de films, avec le Juste Prix, la Star Academy, les matchs de basket-ball, et d’autres matchs de basket-ball, et toujours plus de basket-ball, avec les matchs de football, suivis d’autres matchs de football et de toujours plus de matchs de football. De plus en plus. De plus en plus vite. D’où l’internet, avec les possibilités qu’il offre, toujours plus nombreuses — et spectaculaires — pour tuer le temps. D’où Doom 1, 2 et 3. D’où Half-Life 1, Half-Life 2, et Half-Life épisodes 1 et 2. D’où Second Life, MySpace et YouTube.
D’où la vague massive de pornographie, de sports, d’actualités économiques, avec leurs simulacres de diversité, avec leurs stimulations, avec leurs excitations, et leurs promesses de nous transporter ailleurs, en quelque sorte. D’où les obsessions pour Britney Spears, Paris Hilton, Tom Cruise, Brad Pitt. N’importe qui sauf ceux que l’on a sous les yeux. D’où l’abus de marijuana, de cocaïne, de méthamphétamine. D’où tant d’autres addictions, comme le marché boursier, l’économie, la politique. D’où les visages frénétiquement heureux, frénétiquement souriants — et se ressemblant tous — lors des distractions du soir. D’où l’obsession pour l’amusement de tous ces adultes qui détestent leur travail.
D’où les diversions pour nous divertir des diversions qui nous divertissent des diversions qui nous divertissent de la myriade de choses dont nous ne devons pas prendre conscience si nous voulons continuer à vivre ainsi, en jouant notre rôle dans la destruction très réelle qui est en cours. Et sous cette myriade de réalisations, toujours plus de diversions. Il y a bien cet optimisme creux et insignifiant, cet espoir creux et insignifiant et ces actions creuses et insignifiantes — comme recouvrir de plantes les usines de camions — qui nous empêchent de regarder en face l’abysse de destructivité qui nous fixe actuellement de ses yeux glaçants. Et toutes ces distractions creuses et insignifiantes qui nous divertissent en nous empêchant de comprendre que notre échec et notre inaptitude à regarder cet abysse ne l’empêchera pas de nous avaler, comme tous les autres et tout le reste. Sous ces diversions, des peurs creuses du désespoir, des peurs creuses de la haine, des peurs creuses de la rage, des peurs creuses du chagrin, des peurs creuses de l’amour et des amours : des vrais amours, ces amours intenses de soi et des autres qui nous poussent à tout prix — vraiment à tout prix — à défendre ce que l’on aime.
Et sous toutes ces peurs ? Une peur bleue de la responsabilité, une peur que, si nous en arrivions à cela, si nous survivions à la destruction de ce “moi” — si méticuleusement, si violemment, si répétitivement, si impitoyablement, si inexorablement, si abusivement, si manifestement imposé à chacun de nous afin que nous continuions à respirer, travailler, labourer, produire — nous nous retrouverions responsables de nos actes, et du fabuleux, du magnifique et superbement extravagant cadeau que nous a offert cette planète : la vie. Nous devrions alors agir, et agir de façon à ce que le monde se porte mieux en raison de nos actions, en raison de notre vie, en raison de notre naissance. Et comme pour la soutenabilité elle-même, ce qui fut à un moment aussi simple que manger, chier, vivre et mourir, est maintenant de plus en plus difficile.
Nous craignons la mort. Et pas seulement la mort qui nous attend tous, mais une autre, qui nous effraie bien plus que la vraie mort, ce glas qui retentit à la fin de nos vies creuses. Cette autre mort que nous craignons plus encore survient avant la vraie mort — parfois longtemps avant — si tant est qu’elle survienne. C’est la mort de notre “moi” socialement construit. Une fois que ce “moi” meurt, qui sommes-nous : que devenons-nous ? Nous n’arrivons pas à faire face à la possibilité de vivre vraiment, de vraiment devenir qui nous sommes et qui nous aurions été si nous n’avions pas été si violemment déformés par cette culture. Nous ne pouvons pas faire face à la possibilité d’être vivant, de vivre, alors nous nous tournons — et nous en revenons au début de cette discussion — vers les jet-skis et les véhicules-tous-terrains, vers Disneyland, vers Disneyworld, vers le Futuroscope et vers le Parc Astérix. La plupart d’entre nous préférerions que notre moi réel, notre moi physique meure, et d’ailleurs que le monde lui-même meure, plutôt que de reconnaître que le monde se porterait mieux sans tous ceux qui permettent à leur “moi” socialement construit de continuer à respirer, travailler, labourer, produire — et c’est là tout le problème.
C’est l’option la plus populaire parmi les membres de cette culture.
Traduction: Nicolas Casaux
Filed in Français