"If we wish to stop the atrocities, we need merely to step away from the isolation. There is a whole world waiting for us, ready to welcome us home." Derrick Jensen
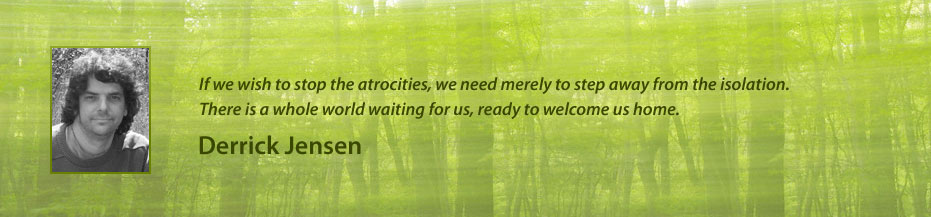
-
See the Archives
- March 2023
- September 2019
- August 2019
- March 2019
- October 2018
- September 2018
- August 2018
- July 2018
- June 2018
- May 2018
- April 2018
- March 2018
- February 2018
- January 2018
- December 2017
- November 2017
- October 2017
- September 2017
- August 2017
- July 2017
- May 2017
- April 2017
- March 2017
- February 2017
- January 2017
- December 2016
- October 2016
- September 2016
- August 2016
- March 2016
- January 2016
- December 2015
- November 2015
- August 2015
- July 2015
- June 2015
- March 2015
- February 2015
- January 2015
- November 2014
- October 2014
- August 2014
- May 2014
- April 2014
- March 2014
- January 2014
- December 2013
- November 2013
- October 2013
- September 2013
- July 2013
- June 2013
- May 2013
- March 2013
- January 2013
- September 2012
- July 2012
- May 2012
- February 2012
- January 2012
- December 2011
- September 2011
- August 2011
- July 2011
- May 2011
- March 2011
- February 2011
- January 2011
- December 2010
- November 2010
- September 2010
- July 2010
- June 2010
- May 2010
- March 2010
- January 2010
- December 2009
- November 2009
- October 2009
- September 2009
- July 2009
- May 2009
- February 2009
- January 2009
- November 2008
- September 2008
- August 2008
- June 2008
- February 2008
- December 2007
- November 2007
- October 2007
- June 2007
- May 2007
- April 2007
- March 2007
- January 2007
- November 2006
- October 2006
- September 2006
- August 2006
- July 2006
- June 2006
- May 2006
- January 2006
- September 2005
- July 2005
- April 2005
- December 2004
- September 2004
- July 2004
- May 2004
- March 2004
- February 2004
- November 2003
- October 2003
- July 2003
- June 2003
- May 2003
- March 2003
- February 2003
- November 2002
- July 2002
- June 2002
- May 2002
- March 2002
- February 2002
- December 2001
- October 2001
- August 2001
- July 2001
- April 2001
- March 2001
- February 2001
- December 2000
- November 2000
- October 2000
- September 2000
- July 2000
- June 2000
- May 2000
- April 2000
- March 2000
- January 2000
- December 1999
- November 1999
- September 1999
- August 1999
- March 1999
- October 1998
- September 1998
- August 1998
- May 1998
- November 1997
- July 1997
- April 1997
- January 1997
- October 1996
- May 1996
- April 1996
- October 1995
- March 1995
- April 1991
- Filter by Category
Du « développement durable » au capitalisme vert
January 1st, 2009[Précision : en anglais, le titre original de ce chapitre est « sustainability ». Nous pourrions traduire ça par « soutenabilité », un mot qui n’existe pas en français, mais qui demeure compréhensible. Le problème, c’est que l’expression « sustainable development » d’origine anglaise, a été traduite en français par « développement durable » ; une mauvaise traduction. Tout au long de ce texte, lorsque le mot « soutenable » est employé, ou « soutenabilité », si cela vous rend la lecture plus aisée, lisez plutôt « durable » ou « durabilité ». Pour plus de renseignements sur les raisons derrière cette mauvaise traduction française, et sur l’oxymore que constitue le « développement durable », vous pouvez lire cet excellent article de Thierry Sallantin.]
Le mot soutenable [ou « durable », NdT] n’est plus qu’un Gloire au seigneur ! pour les éco-adeptes. C’est un mot qui permet aux corporatistes commerciaux, avec leurs bons sentiments « verts » médiatiques, de rejoindre l’impitoyable déni des privilégiés. C’est un mot que je n’ose presque pas utiliser tellement les moralistes paresseux, les individualistes suffisants et les groupies de l’utopie techno-consumériste à venir l’ont vidé de son sens. Douter de cette promesse vague, désormais largement acceptée par l’opinion publique — selon laquelle nous pouvons avoir nos voitures, nos corporations, notre consommation mais aussi une planète — est à la fois une trahison et une hérésie aux yeux de la plupart des progressistes bien-pensants. Mais voilà la question : Voulons-nous nous sentir mieux ou voulons-nous être efficaces ? Sommes-nous des sentimentalistes ou des guerriers ?
— LIERRE KEITH
William McDonough est un architecte de renommée mondiale, qualifié de « prêtre » du « développement durable ». Il reconnaît — comme tous ceux qui possèdent une once d’intégrité et d’intelligence — que cette culture est hautement destructrice, et qu’une partie de cette destructivité est liée au fait que ses déchets n’aident pas le monde naturel, mais au contraire, qu’ils l’empoisonnent. Il affirme justement que dans le monde naturel, « les déchets d’un organisme fournissent la nourriture d’un autre — que les déchets sont de la nourriture ». A la suite de quoi il ajoute qu’il veut changer l’industrie, afin, entre autres choses, que ses déchets deviennent utiles : l’équivalent industriel de ce même principe de déchet-nourriture. Au cœur de sa philosophie, nous dit-il, sont des « principes de design fondamentaux » qui « utilisent des produits composés de matériaux qui se biodégradent et deviennent de la nourriture pour les cycles biologiques, ou de matériaux synthétiques qui ne sortent pas de boucles techniques, où ils continuent à circuler en tant que nutriments importants pour l’industrie. Des principes qui produisent des bâtiments conçus pour utiliser l’énergie solaire, capturer du carbone, filtrer l’eau, créer de l’habitat et fournir un lieu de travail sûr, sain et agréable. De tels designs ne sont pas des stratégies de gestion des dommages. Ils ne cherchent pas à améliorer un système destructeur. Au lieu de cela, ils visent à éliminer le concept même de déchet, tout en fournissant des biens et des services qui restaurent et soutiennent la nature et la société humaine. Ils sont élaborés d’après la conviction selon laquelle le design peut célébrer des aspirations positives et créer une empreinte humaine entièrement positive ». Il en vient au but : « La prospérité sur le long-terme ne dépend pas de ce qu’on rende un système fondamentalement destructeur plus efficient, mais de sa transformation afin que tous ses produits soient sûrs, sains et régénérateurs ».
Il écrit, « Imaginez un bâtiment, intégré au paysage, qui collecte l’énergie du soleil, capture du carbone et produise de l’oxygène. Imaginez des zones humides et des jardins botaniques intégrés, récupérant des nutriments depuis l’eau qui circulerait. De l’air frais, des plantes à fleurs, et, partout, la lumière du jour. La beauté et le confort pour tous les habitants. Un toit végétalisé qui absorbe la pluie. Des oiseaux nichant et se nourrissant de l’empreinte verdoyante du bâtiment. En résumé, un système de support de vie en harmonie avec les flux d’énergie, les âmes humaines et les autres créatures vivantes ».
Sa rhétorique est belle, et la culture dominante l’a bien récompensé pour son travail. Il est à la tête d’un cabinet d’architectes qui porte son nom, composé de 30 collaborateurs. Il a remporté trois récompenses présidentielles états-uniennes : La récompense présidentielle pour le développement durable (1996), Le prix de chimie verte présidentiel (2003), et La récompense nationale du Design (2004). En 1999, le magazine Time l’a qualifié de « héros pour la planète », affirmant que « son utopisme est ancré dans une philosophie unifiée qui — de manière pratique et vérifiable — change le design du monde ».
Comment cela se traduit-il sur le terrain, là où ça importe réellement ?
Examinons brièvement quelques-uns de ses projets.
Tout d’abord, il y a l’usine de camion Ford de Dearborn, dans le Michigan. Le site web de McDonough décrit son travail sur cette usine à l’aide d’un langage qui nous ferait presque oublier qu’il s’agit d’une usine, et qui nous fait totalement oublier ce qu’on y fabrique : « Au centre du projet de revitalisation Ford, cette nouvelle centrale d’assemblage représente l’effort audacieux du client pour repenser l’empreinte écologique d’un grand établissement de fabrication. Son design synthétise l’emphase sur la volonté d’avoir un lieu de travail sûr et sain, avec une approche qui optimise l’impact de l’activité industrielle sur l’environnement ».
Il continue : « La pierre angulaire du système de gestion de l’eau du site est le toit végétalisé d’une surface de 4 hectares — le plus grand du monde. Ce toit « vert » devrait retenir la moitié des précipitations annuelles qui s’y déverseront. Le toit fournira aussi un habitat… avec les bruits d’oiseaux chanteurs nichant au-dessus de la tête des ouvriers, la nouvelle usine de camion de Dearborn offre un aperçu des possibilités transformatrices suggérées par ce nouveau modèle de soutenabilité pour l’industrie ».
L’usine, ce « nouveau modèle de soutenabilité pour l’industrie », fabrique des camions. Des camions. Oui : des camions. McDonough a raison sur un point : ce modèle fournit une « soutenabilité pour l’industrie ». Certainement pas pour le monde naturel.
Il est à la fois absurde et obscène de suggérer que pour la simple raison qu’il ait mis des plantes sur son toit, cette usine est (même un tant soit peu) soutenable. D’où pense-t-il que l’acier des camions (ou, d’ailleurs, de l’usine) provient ? La bauxite pour l’aluminium ? Le caoutchouc pour les pneus ? La production de chacun de ces matériaux est-elle soutenable ? Et qu’advient-il des camions après leur fabrication ? Quels dommages entraînent-ils ? A quel point contribuent-ils au réchauffement climatique ? Une culture basée sur le transport longue distance de gens, de matières premières, et de produits usinés est-elle soutenable ? Une culture qui requiert des camions a-t-elle la moindre chance d’être soutenable ?
Il est facile de fragmenter n’importe quel processus et de dire que ci ou ça ou qu’une partie spécifique de ce processus est soutenable. […]
Considérerions-nous qu’une usine de bombes nucléaires est soutenable parce qu’on y a mis des plantes sur le toit?
Et pour ceux d’entre vous qui pensent que mon saut d’une usine de camions à une usine d’armes nucléaires est infondé, posez-vous la question suivante : étant donné le réchauffement climatique, et étant donné les autres conséquences de la culture de la voiture (et étant donné les implications d’une culture basé sur le transport longue distance de gens, de matières premières et de produits finis), qu’est-ce qui a le plus endommagé la biosphère : les armes nucléaires ou les camions ?
La réponse, bien sûr, est les deux, et plus particulièrement la mentalité qui les a produits.
Ensuite, passons à la description que McDonough donne de son travail sur le siège européen de Nike : « Le commerce de Nike s’articule autour de performances athlétiques de niveau mondial, ainsi, le design de son siège européen aspire à un niveau équivalent de construction et de performance humaine. Le campus créé un habitat actif qui promeut la santé physique, sociale et culturelle au sens large. Les environnements intérieurs ne contiennent pas de PVC, mais du bois acquis de manière soutenable, une lumière du jour abondante et de l’air frais. Une des installations géothermiques les plus grandes d’Europe fournit une bonne climatisation, contribuant à faire du siège européen de Nike l’un des bureaux des Pays-Bas les plus efficaces énergétiquement, proportionnellement à sa taille. Ce design encourage de fortes connexions locales en évoquant le paysage régional d’eau et de plantes locales et en embrassant un riche contexte architectural dont un autre bâtiment d’envergure, conçu par l’architecte d’Hilversum, Willem Dudok, pour les évènements équestres olympiques de 1928 ».
Dans un article qui chante les louanges de son travail sur ce « campus », et également, comme le sous-titre le laissait entendre, du « pas de géant de Nike vers la soutenabilité », McDonough écrit, « Quels sont, se sont-ils [Nike] demandés, les impacts sociaux et environnementaux sur le long terme de l’industrie des chaussures de sport ? Comment une compagnie dont les revenus annuels se chiffrent en milliards (plus de 9 milliards de dollars en 2001) et qui possède plus de 700 contrats d’usines à travers le monde, peut-elle rentablement intégrer l’écologie et l’équité social dans sa manière de commercer, chaque jour, et à tous les niveaux opératoires ? »
Il répond ensuite à cette question : « Plutôt que d’essayer de limiter l’impact de l’industrie à travers la gestion des émissions nocives, la philosophie du ‘berceau-au-berceau’ considère que le design intelligent peut éliminer le concept de déchet, résolvant ainsi le conflit entre la nature et le commerce. En modelant les systèmes industriels sur les flux de nutriments de la nature, les designers peuvent créer des usines hautement productives ayant des effets positifs sur leurs environnements, ainsi que des produits entièrement sains, qui sont soit retournés à la terre soit réinsérés dans les cycles industriels, pour toujours. Il s’agit d’une stratégie pro-vie qui célèbre la créativité humaine et l’abondance de nature — qui correspond parfaitement à la culture positive et innovatrice de Nike ».
McDonough cite le directeur du développement durable corporatiste de Nike (triple oxymore s’il en est un), affirmant que sa philosophie « se fond bien avec la culture ici. Et c’est un message excitant. Si vous parlez de systèmes de gestion environnementale et d’éco-efficience, les gens lèvent les yeux au ciel. Mais si vous parlez d’innovation et d’abondance, c’est inspirant. Les gens sont alors très, très intéressés ».
Bien évidemment, le personnel des échelons supérieurs des corporations est intéressé par le message de McDonough : rien ici ne suggère qu’ils devraient fondamentalement revoir leur manière de commercer, qui les rend riches. Nous en venons finalement au point principal : ils peuvent continuer à exploiter des travailleurs et à détruire la planète, et les timides angoisses qu’ils pouvaient ressentir ne sont plus, parce qu’ils participent désormais à un processus pro-vie, un processus « durable » (ou plutôt, durable™).
Il continue : « Et intéressés ils le furent…en 1996… Nike engagea William McDonough + Partners afin de concevoir un nouveau campus dernier cri pour son siège européen aux Pays-Bas. Complexe de 5 nouveaux bâtiments, le campus fut conçu pour intégrer l’intérieur avec l’environnement, en puisant dans les flux d’énergie locaux afin de créer des relations saines et bénéfiques entre la nature et la culture humaine ».
Mais McDonough et sa philosophie ne se sont pas contentés de créer un magnifique « campus » en Europe où de magnifiques directeurs exécutifs européens peuvent travailler, jouer, manger au bistro, tout en gérant une compagnie qui profite du quasi-esclavage de personnes de couleurs — de jeunes femmes noires principalement — qui travaillent en usine 65 heures par semaine, pour des salaires de misère, à fabriquer des chaussures de sport de luxe ; dans des usines où des produits chimiques causent des dommages au foie, aux reins et au cerveau 177 fois supérieurs à la limite légale (même dans des pays à la législation laxiste comme le Vietnam et la Chine) ; dans des usines où 77 % des employés souffrent de problèmes respiratoires ; dans des usines où la quasi-totalité de ceux qui y travaillent n’auraient ni la force ni le temps de jouer au tennis. Non, la philosophie de McDonough a accompli bien plus que ça ; ainsi que McDonough le souligne fièrement, « D’ici 2010, Nike compte utiliser un minimum de 5% de coton biologique dans tous ses vêtements en coton ».
McDonough conclut, dans un langage qui me donne envie de sortir acheter une paire de Nike : « Nous sommes d’accord. Et que le géant autrefois endormi foule désormais le monde en Air Jordan, ou en chaussette en coton biologique, nous avons été ravi de le voir se lever ».
Cette compagnie que McDonough décrit si éloquemment, si amoureusement, cette compagnie qui « change l’inspiration en action efficace » et qui « fera de même avec tous les défis du chemin vers le durable », c’est Nike. Nike. Nike et ses ateliers-usines. Nike qui fabrique des chaussures de sport de luxe — un produit tout à fait superflu — dans des usines insalubres remplies de jeunes femmes qui ne sont pas assez payées pour manger, encore moins pour soutenir leurs familles, des jeunes femmes qui souffrent souvent de harcèlement sexuel. Nike qui autorise ses employés (pauvres et noirs) à prendre 5 minutes de pause toilette par jour et qui force les femmes à montrer leurs sous-vêtements ensanglantés pour prouver qu’elles ont leurs règles. Nike, qui licencie souvent des employés pour avoir pris un seul jour de congé maladie. Nike, dont 30% des coûts commerciaux, en Indonésie, sont des paiements aux « généraux indonésiens, aux membres du gouvernement, et aux mafieux ». Nike, qui emploie des usines qui brûlent régulièrement du caoutchouc, mais qui le nie ensuite.
Je suis heureux que Nike vise les 5% de coton organique. N’utiliser « que » 95% de coton aux pesticides est certainement mieux que d’en utiliser 100%. Mais nous ne devrions jamais oublier que l’industrie cotonnière esclavagiste du Sud des États-Unis pré-guerre de sécession était 100% biologique. Nike doit encore progresser de 95% afin de se hisser au niveau de cette entreprise infâme.
Nike. McDonough aurait-il applaudi la filiale allemande de la Ford Motor Company (Ford Werke A.G., dont 55 à 90 des actions étaient détenus par Ford USA de 1933 à 1945) pour avoir rendu un petit pourcentage de ses matières premières un peu moins toxique, dans ses usines d’esclavages nazies ? Aurait-il conçu le siège de Bayer, puis écrit des éloges au sujet de l’amélioration de l’utilisation de matériaux dans leurs usines d’esclavages ? Ou de Daimler-Benz ? Ou de compagnies japonaises comme Mitsubishi et Kawasaki, qui utilisaient des pratiques esclavagistes durant la seconde Guerre Mondiale ? McDonough aurait-il vanté leurs mérites s’ils l’avaient embauché pour construire un joli siège d’entreprise et s’ils avaient fourni des matériaux recyclés (ou 5 % de matériaux non-toxiques) pour la construction pour laquelle des esclaves étaient employés ?
Un camp d’esclavage est un camp d’esclavage, peu importe la rhétorique.
Et pour ceux qui pensent que mon saut d’une usine Nike aux camps d’esclavages de la seconde Guerre Mondiale est infondé, considérez les mots du récipiendaire du prix Nobel de la Paix de 1996, José Ramos-Horta : « Nike devrait être traité comme un ennemi, de la même manière que nous considérons les armées et les gouvernements qui sont coupables de violations des droits humains. Quelle est la différence entre l’attitude de Nike en Indonésie et ailleurs, et celle de l’armée impériale du Japon durant la seconde Guerre Mondiale ? »
Enfin, analysons un dernier projet de McDonough. Un « aéroport corporatiste » à Détroit, dans le Michigan. McDonough écrit, à son sujet, que « son design se base sur l’expérience du passager, et cherche à évoquer la merveille du vol aux usagers et au personnel. Une nouvelle séquence d’entrée démarre sous l’abri d’une canopée en forme d’aile, et mène à un atrium central qui définit plus clairement « l’endroité » du terminal pour les deux groupes. L’étendu des vitrages, des puits de lumière, et une impressionnante galerie ouvrent des vues élargies sur les pistes et vers le ciel. En créant un environnement plus vibrant et centré sur l’usager, le nouveau centre améliore le lieu de travail de la communauté des voyageurs aériens, et leur fourni un lieu de rassemblement plus inspirant ».
Il décrit un aéroport corporatiste. Un aéroport. Où des avions atterrissent et décollent. Ce qu’un aéroport — même doté d’un « environnement plus vibrant et centré sur l’usager » — a à voir avec la soutenabilité m’échappe entièrement. Les aéroports ne sont pas soutenables. Ils ne peuvent pas l’être. Ils ne le seront jamais. Une culture basée sur le type de transport de personnes et de matériaux qu’implique un aéroport, ne peut pas être soutenable. Une culture dotée de l’infrastructure physique, sociale, politique et économique rendue possible et renforcée par le transport aérien, ne pourra jamais être soutenable. Les seules cultures soutenables sont les cultures locales, basées sur des relations de prélèvement et de restitution vis-à-vis d’un lieu spécifique. Les seules cultures soutenables sont celles dont les déchets ne sont pas industriels et ne servent pas l’industrie, mais sont organiques et bénéficient à un territoire écologique.
Il y a quelques pages, je mentionnais de manière ironique le fait que le Time magazine ait qualifié McDonough de « Héros pour la planète ». Mais en vérité, si tout ce que McDonough a fait se résume à l’implantation de plantes sur le toit d’usines de camions, à l’incitation de corporations transnationales à recycler plus, et à la construction d’aéroports « vibrants », il ne serait, à mes yeux, qu’un héros de second plan.
J’ai beaucoup écrit sur le fait que cette culture — la civilisation — est incorrigible, et qu’elle se base sur une exploitation et une destruction du monde naturel systémiques et fonctionnellement nécessaires. J’ai écrit sur le besoin de démanteler la civilisation avant qu’elle ne détruise la vie sur cette planète.
Mais j’ai également écrit sur le fait que nous avons besoin de tout. Que nous avons non seulement besoin de gens qui font tout ce qu’ils peuvent pour protéger l’endroit où ils vivent (et/ou qu’ils aiment) — pour protéger la vie elle-même de la destructivité de cette culture et de ses membres (je viens de lire aujourd’hui que le baiji, ou dauphin blanc, qui a survécu pendant 20 millions d’années, venait d’être déclaré éteint) — mais également de gens qui, en attendant, tentent graduellement de rendre cette culture moins destructrice. Prise seule, aucune de ces deux propositions ne suffit. Si nous travaillons tous et attendons le glorieux soulèvement qui renversera cette culture mortifère, il ne restera rien lors de son effondrement. Donc, dans la mesure où McDonough est responsable d’avoir fait baisser de 5% le taux de coton chargé de pesticides utilisé par Nike, je lui suis reconnaissant, et je reconnais et célèbre volontiers l’importance de son travail. Mais de la même manière, si nous ne faisons que bricoler un peu, qu’à peine atténuer la destructivité — et si l’on met de côté la rhétorique, ce que fait McDonough relève, au mieux, de l’atténuation — cette culture continuera à dévorer le vivant, jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien à sauver.
Malheureusement, comme nous l’avons vu, McDonough affirme que son atténuation et son bricolage sont bien plus que ce qu’ils sont. Imaginez à quel point le travail et la rhétorique de McDonough seraient différents s’il avait dit quelque chose comme : « c’est très bien que nous ayons planté des espèces natives sur le toit de cette usine de camion, mais il s’agit d’un tout petit pas, et étant donné la rapidité avec laquelle la civilisation industrielle détruit le monde naturel, ces étapes transitionnelles devraient être bien plus importantes, bien plus rapides. Aujourd’hui, nous plantons des herbes sur le toit d’une usine de camion. Demain nous nous débarrasserons des camions. Le lendemain, nous nous débarrasserons des usines, tandis que nous freinerons et nous orienterons tant bien que mal vers la soutenabilité. Le design de cette usine n’est absolument pas soutenable, et bien que je sois flatté que certains le considèrent ainsi, je ne peux accepter ces louanges, puisque nous n’avons pas le temps de nous illusionner sur la magnitude des changements nécessaires, de ce qui doit être défait, et de ce à quoi nous devons immédiatement renoncer. Cependant, ce design est un mouvement, et nous avons désespérément besoin de mouvement — de n’importe quel mouvement — dans la bonne direction ». Si McDonough avait dit un tout petit quelque chose d’aussi honnête que ça, il serait (pour ce que ça vaut) un de mes plus grands héros.
Bien sûr, il ne dit rien de tel. S’il le faisait, Ford, Nike, et ainsi de suite, ne l’embaucheraient jamais, et les présidents Clinton et Bush ne lui attribueraient certainement pas de récompenses pour la soutenabilité™. Le magazine Time ne l’appellerait pas un « héros pour la planète ».
Malheureusement, ce type de renforcement social de pseudo-solutions est une immense (et nécessaire, et routinière) partie du problème. Nous pourrions formuler les mêmes analyses vis-à-vis de n’importe quel « capitaliste vert » ou « forestier vert », ou « entrepreneur vert », de Paul Hawken à Amory Lovins, et Al Gore, qui essaient de nous raconter, contre l’évidence, que les changements non-systémiques peuvent transformer un système fondamentalement injuste et insoutenable en quelque chose qu’il n’est manifestement pas. La civilisation industrielle détruit la vie sur Terre. Comme je l’ai mentionné auparavant, quiconque possède une once d’intelligence et d’intégrité le comprend (qu’ils l’énoncent publiquement ou pas, qu’ils l’admettent consciemment ou pas). Cependant, admettre que la civilisation industrielle détruit la planète peut être incroyablement menaçant, et effrayant, particulièrement lorsque notre mode de vie, notre métier, notre célébrité, notre fortune, notre pouvoir et notre identité dépendent de la continuation de l’économie industrielle, et plus fondamentalement, du système de Ponzi géant que l’on appelle la civilisation industrielle. Et si cette réalisation est effrayante, si elle menace notre identité, si elle menace de nombreuses choses auxquelles nous tenons, si cette réalisation nous menace en menaçant ce dont nous avons été rendus dépendants (pourriez-vous survivre sans la civilisation industrielle ? Où obtiendriez-vous votre eau ? Votre nourriture ? Vos chaussures de sport ?), nous aurons souvent tendance à réagir en recherchant n’importe quelle excuse nous permettant de l’éviter ; nous nous accrocherons à la première rationalisation bancale concoctée par n’importe qui (mais particulièrement par des figures d’autorité), qui puisse nous permettre de maintenir notre vieux mode de vie, contre toute évidence, toute logique, toute intuition, peu importe son degré de destructivité. Ainsi que je l’ai écrit sur la première page d’Un langage plus ancien que les mots : « Afin de maintenir notre mode de vie, nous devons, au sens large, nous mentir les uns aux autres, et particulièrement à nous-mêmes. Il n’est pas nécessaire que les mensonges soient particulièrement plausibles. Les mensonges servent de remparts contre la vérité. Ces remparts contre la vérité sont nécessaires, parce que, sans eux, de nombreux actes déplorables deviendraient impossibles ».
Il s’agit précisément de ce que fait McDonough (et Hawkins, Levins, Gore, etc.). Il nous abreuve de douces et rassurantes histoires, les unes après les autres, toutes porteuses du même message destructeur, qui se résume à : la civilisation industrielle peut continuer, si seulement nous apportons quelques changements mineurs et les qualifions de grandes transformations.
Nous savons tous que ce mode de « vie » ne marche pas. Nous savons tous que quelque chose doit changer. Nous savons que ce changement doit être drastique. McDonough corrompt cette réalisation de la nécessité d’un changement radical et redirige cette énergie au service du système qui est en train de détruire la vie. Il nous endort avec succès : Ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer ; Ford plante désormais de l’herbe sur le toit de ses usines de camion. Une révolution est en cours.
J’imagine déjà les publicités.
Je ne pense pas que McDonough tente intentionnellement de nous induire en erreur. Je pense qu’il fait ce que font beaucoup d’entre nous, ce que Robert Jay Lifton décrit de manière si éloquente dans son livre crucial, « Les médecins nazis ». Ce dont je parle dans d’autres livres, et dont je parle encore ici en raison de l’importance de ce que Lifton expose, et parce que les actions qu’il décrit se produisent si fréquemment.
Lifton voulait savoir comment des médecins — des gens ayant prêté le serment d’Hippocrate — pouvaient travailler dans les camps de concentration et les camps de la mort des nazis. Il ne parlait pas tant de Mengele et de ses semblables (bien qu’il discute effectivement de Mengele), mais simplement des médecins allemands ordinaires. Il souligne quelque chose d’assez extraordinaire, qui est que beaucoup de ces docteurs se souciaient réellement des prisonniers, et faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour rendre leur condition légèrement plus supportable. Ils pouvaient donner de l’aspirine à leurs détenus malades. Les mettre au lit. Leur donner un peu plus de nourriture. Encore une fois, les médecins faisaient tout ce qu’ils pouvaient. Tout, sauf la chose la plus importante : ils ne remettaient pas en question l’existence des camps eux-mêmes. Ils ne remettaient pas en question le travail à mort des détenus. Ils ne remettaient pas en question leur affamement volontaire. Ils ne remettaient pas en question leur gazage létal. Ils ne remettaient pas en question l’hubris, le sectarisme, la prérogative d’exploitation et l’utilitarisme qui menèrent aux camps. Ils ne remettaient pas en question la fonction des camps. Ils n’entravaient pas les opérations des camps. Dans le cadre de ces contraintes, ils atténuaient les choses du mieux qu’ils pouvaient.
Et que fait McDonough, précisément ? Il semble faire tout ce qui est en son pouvoir pour rendre les usines imperceptiblement moins destructrices (tout en s’assurant, bien sûr, de ne jamais entraver leur fonctionnement entrepreneurial : il insiste bien sur le fait que son travail augmente les profits de la corporation qui l’engage), c’est-à-dire qu’il fait tout sauf la chose la plus importante : remettre en question l’existence des usines. Il fait tout sauf remettre en question l’hubris, le sectarisme, la prérogative d’exploitation et l’utilitarisme qui font que la planète entière est transformée d’abord en un camp de travail, ensuite en un camp de la mort (demandez aux océans, aux prairies et aux forêts si vous en doutez). Il ne remet pas en question le travail à mort de la planète. Il ne remet pas en question son affamement létal. Il ne remet pas en question son empoisonnement létal. A l’instar des médecins nazis, il ne fait que le peu qui lui est permis de faire dans le cadre des contraintes qu’il refuse de remettre en question.
Un des problèmes est que McDonough, comme beaucoup, prétend que la culture qu’il sert est primordial, et que le monde est secondaire (ou, plus précisément, que cette culture et ses droits autoproclamés d’exploiter et de détruire sont la seule chose qui existe réellement, et que tout le reste doit se conformer à cette « réalité »). Le travail de McDonough, comme le travail de beaucoup, ne remet pas en question, ne peut pas remettre en question, cette culture et ses droits autoproclamés d’exploiter et de détruire. Comme beaucoup, il prend cette culture pour une constante à laquelle tout le reste doit s’adapter, ou, à l’instar du baiji, et de tant d’autres, mourir. Il oublie que cette culture — que n’importe quelle culture — dépend de la santé de la terre. Sans une terre saine, pas de culture. D’ailleurs, sans terre saine, pas de vie. Le premier principe de la soutenabilité est et doit être que la santé de la terre est primordiale, et que tout le reste — vraiment, tout le reste — lui est subordonnée. Demander « Comment cette usine pourrait-elle être soutenable ? » revient à poser la mauvaise question, et garantit l’insoutenabilité, parce que cette question sous-entend la prémisse selon laquelle les usines pourraient être soutenables, et considère l’existence des usines comme une constante. Cela revient à demander, « comment rendre les camps de concentration / de la morts plus soutenables pour les détenus (le bétail de la productivité des camps) ? » Dans le deux cas, la question devrait être, « que faut-il pour que la terre (ou les détenus) soient en bonne santé ? » La plus évidente et la plus importante réponse à cette question est la destruction des superstructures qui entraînent les dommages : les usines et plus largement la civilisation industrielle qui les crée, dans le premier cas, et les camps et le gouvernement nazi qui les crée, dans le second.
Nous percevons cela bien plus facilement du fait de la distance historique.
Je serais encore plus direct, tant d’entre nous, moi-même y compris, ayant été rendus systématiquement déments et individuellement stupides (ou, ainsi que R. D. Laing aurait pu le formuler, ont été changés en imbéciles aux QI élevés). Cette stupidité organisée est nécessaire, bien sûr, sans quoi nous démantèlerions le misérable système qui détruit la planète au lieu d’aménager ses usines, en qualifiant notre travail de soutenable, et en continuant à attendre du monde naturel qu’il s’accommode de tout ce que nous voulons lui imposer (des usines de camion, des fabriques de chaussures de sport, des aéroports, des corporations transnationales, des livres produits en masse (dans mon cas), et l’industrie et la civilisation, par exemple). Si nous voulons survivre, nous devons nous adapter à la terre, lui donner ce dont elle a besoin et respecter ce qu’elle veut, n’accepter d’elle que ce qu’elle veut que nous ayons.
Ce n’est pas si difficile. C’est ainsi que les humains ont vécu pendant la majeure partie de leur existence, et c’est ainsi que vivent les non-humains. Il s’agit de la seule manière de survivre. De la seule manière de vivre de façon soutenable. Sans cela, si vous abîmez votre terre, votre habitat, vous ne survivrez pas.
Notre stupidité et notre déni aggravent d’autant plus la dangerosité de la rhétorique de McDonough. Ils nous empêchent de considérer les usines pour ce qu’elles sont — des structures-machines qui transforment les membres du monde naturel en choses, qui convertissent le vivant en inerte (les forêts en planches de bois, les montagnes en châssis de camion, et ainsi de suite) — ainsi, les usines soutenables™ deviennent les villages Potemkine de notre temps.
Les villages Potemkine, souvenez-vous, étaient les villages-façades censés être construits par le ministre russe Grigori Aleksandrovitch Potemkine le long des berges du fleuve Dniepr, afin d’impressionner sa bien-aimée, l’impératrice Catherine II. Que cette histoire selon laquelle il aurait créé ces faux villages soit elle-même fausse n’a pas empêché l’expression de devenir d’usage courant, désignant quelque chose qui semble impressionnant mais qui, en réalité, est creux, qui n’est qu’une simple tromperie.
J’ai une amie qui n’a jamais ramassé de déchets le long d’une route. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m’a dit qu’elle voulait que les gens voient cette culture dans toute son horreur et tout son gâchis, et qu’elle ne voulait pas nettoyer un bas-côté de manière superficielle — un bas-côté ! — et ainsi faciliter l’illusion selon laquelle ce mode de vie est autre chose que sale et gaspilleur.
Je respecte son point de vue, bien que je ramasse des déchets dès que j’en ai l’occasion, je trouve qu’elle n’a pas tort.
Je pense la même chose, encore une fois, du travail de McDonough. Si on le considère pour ce qu’il est — un nettoyage superficiel — c’est alors un travail défendable. Mais la mesure selon laquelle ces usines deviennent des « usines Potemkine » — dans la mesure où son travail dissimule le fait indiscutable que ces usines, et, plus largement, ce mode de vie, sont sales, destructeurs, exploiteurs, et insoutenables — est la mesure selon laquelle son travail est plus nuisible que bénéfique.
Au cours des dernières semaines que m’a pris l’écriture de cette analyse de McDonough, je n’ai pas arrêté de penser à quelque chose que j’ai appris en commençant à écrire dans le but d’être publié. J’ai commencé par des critiques de livre. On m’a dit de poser trois questions, quel que soit le livre : Quel était l’objectif de l’auteur ? A quel point a-t-il réussi ? Et, cela valait-il le coup d’être fait ?
Prenons le livre Les médecins nazis. J’ai répondu à ces questions dans mon paragraphe qui l’introduisait. Quel était l’objectif de l’auteur ? Il analysait comment des gens ayant prêté le serment d’Hippocrate — des gens censés avoir un bon cœur — pouvaient participer à une entreprise aussi diabolique et aussi destructrice. A quel point a-t-il réussi ? Ce livre est crucial. Cela valait-il le coup d’être fait ? Encore une fois, le livre est crucial.
Nous pourrions faire la même chose avec n’importe quel livre, et d’ailleurs, avec n’importe quelle action. Quel était l’objectif de George Bush et de sa décision d’envahir l’Irak ? Certainement d’obtenir le contrôle des champs de pétrole irakiens. Il tentait également de protéger Israël et de renforcer le contrôle US du Moyen-Orient. A quel point a-t-il réussi ? Assez mal. Cela valait-il le coup d’être fait ? Je ne pense pas. Ou peut-être que je me trompe complètement, et que l’objectif était d’augmenter le pouvoir du gouvernement des USA sur ses propres concitoyens, et que Bush et ses alliés avaient besoin d’une guerre comme excuse pour y parvenir. A quel point a-t-il réussi ? Jusqu’ici, cela a fonctionné. Cela valait-il le coup d’être fait ? Il n’a pas encore été jugé ni pendu pour avoir piétiné la constitution des USA, pour avoir ordonné la torture et la détention illégale de milliers d’individus, et pour avoir causé la mort de centaines de milliers d’autres, donc, de son point de vue, et de ceux de ses potes autocrates, oui. Ou peut-être que je me trompe encore, et qu’en réalité George Bush est un révolutionnaire infiltré qui cherche à détruire l’empire des Etats-Unis à travers des dépenses militaires démesurées, et des politiques étrangères, domestiques et fiscales qui garantissent le crash de l’économie. A quel point a-t-il réussi ? Mieux que le pire ennemi des USA n’aurait pu l’espérer. Cela valait-il le coup d’être fait ? Bonne question.
Quel est l’objectif de McDonough ? Une réponse possible est qu’il tente de rendre les usines moins destructrices. A quel point a-t-il réussi ? McDonough a réussi à planter des plantes sur une usine de camion Ford, et il a été associé avec le fait que Nike n’utilisera plus que 95% de coton chargé de pesticides. Cela valait-il le coup d’être fait ? McDonough devrait se poser cette autre question, similaire : est-il souhaitable de construire une usine de fabrique de camion ? La construction d’une usine de camion — peu importe à quel point elle est savamment réalisée — est-elle favorable à la soutenabilité, et plus largement à la survie des humains (et des non-humains) ? Que vous fassiez particulièrement bien quelque chose qui ne devrait pas être fait n’a pas grande importance : cela ne devrait pas être fait.
Ou peut-être que McDonough essaie de nous faire croire que la civilisation industrielle peut être soutenable. A quel point a-t-il réussi ? Selon Ford, Nike, deux présidents, beaucoup de libéraux — aujourd’hui même, le San Francisco Chronicle l’a qualifié de « star du mouvement de la soutenabilité » — et beaucoup d’écologistes grand public, il y arrive extrêmement bien : ils ne semblent jurer que par lui, ou, plus précisément, ils jurent davantage par lui que par le monde réel, qui est détruit par la civilisation industrielle qu’il tente supposément de rendre plus soutenable.
Tout cela étant dit, je ne voulais toujours pas écrire cette section. Je déteste dire des choses négatives sur les gens qui se dirigent ne serait-ce qu’à peine dans la bonne direction. Par exemple, bien qu’il y ait beaucoup d’activistes que j’apprécie beaucoup, il y en a aussi beaucoup qui me laissent indifférent ou que je déteste ouvertement (parfois en raison de différends que j’ai avec leur travaux, et parfois parce que même si je pense que leur ouvrage est bon ou important, je les connais et ne peux pas les supporter personnellement : ce sont des abrutis). Je ne dis pas de mal d’eux en public. J’essaie de réserver mon venin pour ceux qui sont mes vrais ennemis. Je pense qu’il est nuisible, en général, de passer beaucoup de temps à attaquer des alliés potentiels.
Ce point est important au point que je m’apprête à vous raconter deux histoires à son sujet. La première est que peu après la publication de mon livre « Un langage plus ancien que les mots », on m’a demandé de participer à une conférence sur la défense de la santé des enfants. L’organisateur m’a dit qu’elle voulait la perspective d’un activiste écologiste, et qu’elle voulait que je « remue un peu les choses ». La conférence fut, du moins pour moi, deux jours en enfer. Dès que je soulignais quelque chose à propos de la destruction du monde naturel, on me demandait, d’une manière ou d’une autre, de la fermer : dans l’esprit de beaucoup de ces défenseurs de la santé des enfants, il n’y avait aucune corrélation entre les bébés saumons malades et les bébés humains malades. Une femme m’approcha durant une pause, et me dit : « j’aimerais que vous arrêtiez de gâcher le temps de toutes ces personnes brillantes avec votre discours sur une sorte d’apocalypse ». Au cours d’une session consacrée aux problèmes environnementaux, j’ai parlé, dans mon groupe, de la destruction de la biosphère et de ses effets sur les enfants humains et non-humains (ainsi, bien sûr, de ses effets sur les enfants humains et non-humains à venir, qui hériteront d’un monde invivable). Notre secrétaire de groupe nota scrupuleusement tout ça au tableau. Après, tandis que je quittais la pièce, j’ai remarqué que quelqu’un qui n’avait pas dit grand-chose s’adressait à la secrétaire, en lui montrant le tableau où mes commentaires étaient écrits. Quelques moments plus tard, lorsque la secrétaire sorti le tableau pour présenter la discussion de notre groupe au reste des conférenciers, je me suis aperçu que tous mes commentaires avaient été effacés. J’ai appris plus tard que la personne qui s’était approchée de la secrétaire exerçait le métier de lobbyiste. Cela m’a permis de comprendre les processus tordus à l’origine de nos lois. Mais le pire a été la fin de la conférence. Quelqu’un mentionna PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, en français, « Pour une Ethique dans le Traitement des Animaux », une association à but non lucratif dont l’objet est de défendre les droits des animaux), et la salle entra en éruption tandis que les gens sifflaient et criaient, parce que PETA s’oppose à la vivisection. Je m’adressai alors à ces défenseurs de la santé des enfants et leur dit que bien que je trouve PETA absurde et rebutante, je me devais de souligner que les gens de cette conférence manifestaient bien plus d’hostilité envers PETA que je les avais entendus en manifester à l’égard de Monsanto. Je leur ai alors demandé pourquoi.
Quelqu’un me répondit : « parce que PETA déteste les enfants ».
Je ne comprenais pas bien.
Il continua : « Ils tuent des enfants en s’opposant aux tests des produits chimiques toxiques sur les animaux ».
« Non, répondis-je, Monsanto tue des enfants en fabriquant des produits chimiques toxiques ».
« Vous devez, vous aussi, haïr les enfants », rétorqua-t-il.
Non. Je n’invente rien.
Quelqu’un d’autre déclara, de manière lasse et quelque peu condescendante, « sans tests sur les animaux, comment régulerons-nous la production de ces substances chimiques toxiques ? »
« Je ne m’intéresse pas à la régulation de la production des substances chimiques toxiques », lui répondis-je.
La salle explosa. La première personne s’exclama, « Ha ! Je le savais, il déteste les enfants! Je le savais depuis le début ! »
Ce à quoi je répondis que j’étais « simplement contre la production de substances chimiques toxiques, en premier lieu ».
Les visages étaient rouges de colère. Les poings serrés. Non, je n’invente rien. J’étais heureux qu’un des individus présents, en particulier, n’ai pas eu de flingue ou de corde à disposition.
J’ajoutai ensuite, « je pense que nous ne devrions approuver l’empoisonnement d’aucun enfant — humain ou non-humain — par Monsanto ou n’importe quelle autre corporation ».
L’homme au visage rouge, mais qui n’avait ni flingue ni corde, me hurla dessus. Le lobbyiste s’exprima virulemment : « Vous devriez passer plus de temps dans le monde réel ».
Dégouté, je me suis retiré. Non seulement ai-je été dégouté par leur amalgame de la situation politique actuelle, et, plus largement, de la civilisation, avec le « monde réel » (tandis que dans le monde réel, le lait maternel réel a réellement été rendu toxique par des produits chimiques). Et par le fait qu’ils étaient tombés dans le même piège que McDonough et que les médecins nazis — qui consiste à ne faire que le peu qu’il nous reste lorsqu’on ne remet pas en question les contraintes que cette culture de camps de la mort nous impose, lorsqu’on ne remet pas en question cette culture des camps de la mort elle-même. Et parce qu’ils tombaient dans un autre piège dans lequel tombent nombre de ceux qui ont été rendus relativement impuissants, qui consiste à évacuer sa colère contre d’autres individus tout aussi impuissants au lieu de la déverser contre ceux qui leur causent vraiment du tort — en l’occurrence Monsanto et d’autres producteurs de produits chimiques, dont beaucoup sont toxiques. Mais j’ai surtout été dégouté parce que je suis fatigué par les luttes intestines et les attaques mesquines qui caractérisent un large pan de notre soi-disant résistance. Leurs attaques contre PETA puis contre moi n’avaient aucun sens, et pourtant, elles ne me surprenaient pas, parce qu’il s’agit de ce que font beaucoup de ceux qui prétendent au moins s’opposer au système — s’attaquer les uns les autres.
Ce qui m’amène à ma seconde histoire. Au cours des dernières années, j’ai reçu environ 700 e-mails de haine. Deux, seulement, étaient écrits par des individus de droite. (L’un d’eux était une menace de mort lié au fait que j’ai partagé une tribune avec Ward Churchill ; son auteur n’avait même pas la politesse de me menacer en raison de mon propre ouvrage, mais me menaçait en raison de celui de quelqu’un d’autre. L’autre provenait de quelqu’un qui me reprochait d’utiliser des analyses quantitatives pour prouver un de mes points ; je ne comprends toujours pas ce qui n’allait pas.) Tous les autres émanaient de ceux dont j’aurais pensé qu’ils étaient des alliés. Des végétariens et des vegans m’écrivent des mails de haine parce que je mange de la viande. Des promoteurs de la permaculture m’écrivent des mails de haines parce que je ne pense pas que le jardinage seul empêchera cette culture de détruire la planète. Des pacifistes m’écrivent des mails de haines parce que je dis que parfois, il est juste de riposter. Des autostoppeurs m’ont écrit des mails de haines parce que je prends l’avion pour me rendre à des conférences. Des gens qui ne font pas grand-chose m’ont écrit des mails de haines parce que mes livres sont imprimés sur de la chair d’arbres. Un trotskiste (je ne savais pas qu’il en restait) m’a écrit une note qui commençait par, « Je vous hais. Je vous hais. Vous êtes un anarchiste alors je vous hais ». Des anarchistes m’ont écrit des mails de haines parce qu’ils disent que je ne suis pas assez anarchiste. Et cela continue.
Il s’agit d’un gâchis monumental ; j’aimerais que ces gens dévouent leur temps, leur énergie et leur émotion à lutter contre la culture qui détruit la planète.
Cela se produit tellement souvent que cela porte un nom : l’hostilité horizontale. Elle a détruit de nombreux mouvements de résistance contre cette culture, et a poussé de nombreux individus à les déserter. Il est bien plus simple d’attaquer ses alliés pour des erreurs mineures que de s’attaquer à Monsanto, à Wal-Mart, à Ford, à Nike, à Weyerhaeuser, et ainsi de suite.
C’est pour cette raison que j’ai hésité à écrire cette section. Serais-je en train de faire la même chose ? Je n’étais pas sûr. J’ai écrit à mon amie activiste Lierre Keith, pour lui demander si je faisais bien d’écrire une critique de McDonough. Après tout, il se dirige dans la bonne direction.
Elle me répondit qu’au final, « McDonough ne se dirige pas dans la bonne direction. Il se dirige exactement dans la direction habituelle — l’épuisement complet des réserves planétaires de métaux, de pétrole, d’eau, de tout — mais simplement, de manière légèrement moins rapide. L’industrialisation reste l’industrialisation. Ce mode de vie est terminé. Il doit changer.
Son travail offre une échappatoire émotionnelle/intellectuelle à ceux qui, autrement, auraient eu à affronter les faits : ‘Regarde ! L’institut des montagnes rocheuses a développé une voiture qui fait du 4 litres aux 100 !’ Ah oui ? Et alors ? D’où proviennent l’acier et le plastique ? Et l’asphalte ? Et le principal problème reste que si nous construisons pour les voitures — ou pour les usines de camion, etc. — nous ne pouvons pas construire pour les humains et les autres communautés biotiques : les voitures requièrent l’inverse.
Les camions et une économie basée sur ce genre de distances de transport ne seront jamais soutenables. Pourquoi sommes-nous, en tant que culture, en train de gâcher notre temps et nos ressources pour construire ne serait-ce qu’un seul autre putain de camion ?
Je pense que le projet est corrompu et qu’il ne fait que repousser l’inévitable. Ils se battent pour un mode de vie qui nécessite la destruction de la planète. »
Elle a raison. J’ai donc écrit cette critique.
Dans son puissant livre Overshoot: The Ecological Basis for Revolutionary Change (non-traduit ; en français : « Excès / Dépassement : les bases écologiques pour un changement révolutionnaire »), William R. Catton définit un terme que je n’ai lu nulle part ailleurs. Il s’agit de cosmétisme : « la foi en ce que des ajustements relativement superficiels de nos activités vont assurer la maintenance du Nouveau Monde et perpétuer l’âge de l’exubérance ».
Je viens de recevoir aujourd’hui un e-mail automatique envoyé par une organisation appelée la Crisis Coalition (en français : Coalition de crise). Il détaille de manière effroyable la fonte des glaciers, les émissions de méthane qui génèrent des boucles de rétroactions alimentant le réchauffement climatique, et ainsi de suite : en gros, le meurtre de la planète.
Et comment cet e-mail passionné finit-il ? En disant : « Nous pouvons transformer notre vie sur cette planète, et maintenir nos modes de vie. Nous pouvons faire les deux — si nous nous y mettons dès MAINTENANT ».
Comment quelqu’un qui comprend que ce mode de vie détruit la planète peut-il persister à dire que nous pouvons maintenir ce mode de vie et ne pas tuer la planète ?
Notre déni nous rend vraiment stupides.
Vraiment, vraiment stupides.
Suis-je le seul à ressentir une profonde tristesse lorsque quelqu’un que l’on qualifie de « Héros pour la planète » et de « star du mouvement de la soutenabilité » conçoit des usines de camion et des sièges entrepreneuriales pour Nike ? 90% des grands poissons des océans ne sont plus. 97% des forêts anciennes du monde ont été coupées. Il y a 2 millions de barrages aux États-Unis. Les grandes nuées de tourtes voyageuses ne sont plus. Les îles peuplées de grands pingouins, disparues. Les cours d’eau peuplés de saumons, disparus. Disparus. Disparus. Disparus. Les océans sont remplis de plastiques. Tous les cours d’eau des États-Unis sont contaminés par des carcinogènes. Le monde est en train d’être détruit, et voilà la réponse ? Non seulement suis-je en colère, et dégouté, mais aussi profondément triste.
Et j’ai extrêmement honte.
Nous devons agir autrement.
Traduction : Nicolas Casaux
Filed in Français