"If we wish to stop the atrocities, we need merely to step away from the isolation. There is a whole world waiting for us, ready to welcome us home." Derrick Jensen
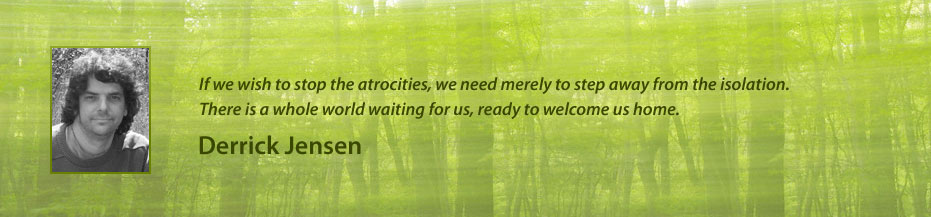
-
See the Archives
- March 2023
- September 2019
- August 2019
- March 2019
- October 2018
- September 2018
- August 2018
- July 2018
- June 2018
- May 2018
- April 2018
- March 2018
- February 2018
- January 2018
- December 2017
- November 2017
- October 2017
- September 2017
- August 2017
- July 2017
- May 2017
- April 2017
- March 2017
- February 2017
- January 2017
- December 2016
- October 2016
- September 2016
- August 2016
- March 2016
- January 2016
- December 2015
- November 2015
- August 2015
- July 2015
- June 2015
- March 2015
- February 2015
- January 2015
- November 2014
- October 2014
- August 2014
- May 2014
- April 2014
- March 2014
- January 2014
- December 2013
- November 2013
- October 2013
- September 2013
- July 2013
- June 2013
- May 2013
- March 2013
- January 2013
- September 2012
- July 2012
- May 2012
- February 2012
- January 2012
- December 2011
- September 2011
- August 2011
- July 2011
- May 2011
- March 2011
- February 2011
- January 2011
- December 2010
- November 2010
- September 2010
- July 2010
- June 2010
- May 2010
- March 2010
- January 2010
- December 2009
- November 2009
- October 2009
- September 2009
- July 2009
- May 2009
- February 2009
- January 2009
- November 2008
- September 2008
- August 2008
- June 2008
- February 2008
- December 2007
- November 2007
- October 2007
- June 2007
- May 2007
- April 2007
- March 2007
- January 2007
- November 2006
- October 2006
- September 2006
- August 2006
- July 2006
- June 2006
- May 2006
- January 2006
- September 2005
- July 2005
- April 2005
- December 2004
- September 2004
- July 2004
- May 2004
- March 2004
- February 2004
- November 2003
- October 2003
- July 2003
- June 2003
- May 2003
- March 2003
- February 2003
- November 2002
- July 2002
- June 2002
- May 2002
- March 2002
- February 2002
- December 2001
- October 2001
- August 2001
- July 2001
- April 2001
- March 2001
- February 2001
- December 2000
- November 2000
- October 2000
- September 2000
- July 2000
- June 2000
- May 2000
- April 2000
- March 2000
- January 2000
- December 1999
- November 1999
- September 1999
- August 1999
- March 1999
- October 1998
- September 1998
- August 1998
- May 1998
- November 1997
- July 1997
- April 1997
- January 1997
- October 1996
- May 1996
- April 1996
- October 1995
- March 1995
- April 1991
- Filter by Category
Le cauchemar des zoos
June 15th, 2007Ce texte est une compilation d’extraits tirés de son livre “Thought to exist in the Wild”Censés exister en liberté”).
Karen Tweedy-Holmes m’a abordé avec ses photos épouvantablement tristes d’animaux prisonniers des zoos. Je voulais écrire quelque chose faisant honneur à son travail, honneur à la souffrance de ces animaux, et tenter de mettre un terme à ces souffrances en aidant à briser le mythe selon lequel les zoos aident les animaux. Je voulais aider à mettre fin aux zoos. Une des choses dont je suis particulièrement fier, dans ce livre, est le lien que j’établis entre les zoos et la pornographie. Dans les deux cas, cela nécessite qu’il y ait un sujet, le regard braqué sur un objet dont il a le contrôle, un objet essentiellement retenu captif et exploité, à des fins purement éducatives et divertissantes vis-à-vis du sujet. La leçon la plus importante enseignée par les zoos et la pornographie, est que moi, le spectateur, j’ai du pouvoir sur toi, qui es dans la cage.
L’ourse fait sept pas, ses griffes crissent sur le ciment. Elle baisse la tête, se retourne et fait trois pas vers l’avant de la cage. Elle baisse à nouveau la tête, se retourne et de nouveau fait sept pas. Lorsqu’elle revient à son point de départ, elle recommence. Puis recommence une nouvelle fois, toujours et encore.
C’est tout ce qu’il reste de sa vie.
A l’extérieur de la cage, les gens déambulent dans une allée. Les poussettes n’ont pas le temps de s’arrêter complètement avant que leurs conducteurs réalisent qu’il n’y a rien à voir. Ils poursuivent leur chemin. L’ourse fait toujours les cent pas, baisse la tête, se retourne. Un couple d’adolescents approche, qui se tiennent par la main, écouteurs dans les oreilles. Un coup d’œil à l’intérieur est suffisant, ils sont déjà en route pour la cage suivante. Trois pas, baisse la tête, change de direction.
Mes doigts s’étaient fermement agrippés à la rampe métallique de l’enceinte extérieure. Je m’aperçois qu’ils sont douloureux. J’ai la gorge serrée. L’ourse fait toujours les cents pas. Je regarde l’argenté de son dos, la concavité de son nez. Sept pas, baisse la tête, demi-tour. Je me demande depuis combien de temps elle est là. Un père et son fils approchent, ne restent pas longtemps à mes côtés. Trois pas, baisse la tête, demi-tour. Je lâche la rampe, fais demi-tour et alors que je m’éloigne, j’entends, qui s’estompe lentement, le cliquetis rythmé des griffes sur le ciment.
***
Un zoo est un cauchemar qui prend la forme de ciment et d’acier, de fer et de verre, de douves et de clôtures électriques. Pour ses victimes, c’est un cauchemar sans fin dont la seule issue est la mort.
***
Le directeur de zoo David Hancocks a écrit une phrase que beaucoup d’autres reprennent en cœur: « les zoos ont évolué de façon indépendante dans toutes les cultures du monde ». Nombreux sont ceux qui répètent cette affirmation, pourtant inexacte. Cela revient à dire que le droit divin des rois, la science cartésienne, la pornographie, l’écriture, la poudre à canon, la tronçonneuse, le tractopelle, le bitume et la bombe nucléaire ont évolué de façon indépendante dans toutes les cultures du monde. Certaines cultures ont développé certaines de ces choses, et d’autres, non. Certaines cultures ont conçu des zoos, et d’autres non. Les cultures humaines existaient des milliers d’années avant l’apparition du premier zoo, il y a 4300 ans de cela, dans la ville sumérienne d’Ur, ce qui signifie que ces cultures n’ont pas conçu les zoos. Et, depuis ce premier zoo, des milliers de cultures ont existé — certaines jusqu’à aujourd’hui (jusqu’à ce que la culture dominante finisse par toutes les éradiquer) — sans qu’on y constate la présence de zoos, ou leur équivalent.
En revanche, les zoos se sont développés du Sumer antique à l’Égypte, à la Chine, à l’Empire mogol, à la Grèce et à Rome, en suivant l’évolution de la civilisation occidentale jusqu’à nos jours. Mais ces cultures partagent quelque chose que ne partagent pas les cultures indigènes comme les San, les Tolowa, les Shawnee, les Aborigènes, les Karen et toutes celles qui n’avaient pas ou n’ont pas de zoo : elles sont civilisées. La substitution d’un seul mot rectifie la phrase d’Hancocks: « les zoos se sont développés de façon indépendante dans toutes les civilisations du monde ».
Ainsi que l’écrit Michael H. Robinson, directeur du Parc zoologique national de Washington, « La période de la civilisation correspond à environ 1% de notre histoire d’hominidés. Avec la civilisation vint l’urbanisation. Peu après que l’on ait développé des villes à grande échelle, les zoos et les jardins botaniques émergèrent dans des pays aussi éloignés que l’Egypte et la Chine ».
Les civilisations sont des modes de vie caractérisés par la croissance de villes. Les villes détruisent l’habitat naturel et créent des environnements hostiles à la survie de nombreuses créatures sauvages. Par définition, les villes séparent leurs habitants humains des non-humains, les privant du contact et du voisinage journalier de créatures sauvages qui, jusqu’à l’aube des civilisations — et donc, durant 99% de notre existence — étaient au cœur des vies de tous les humains, et qui demeurent au cœur des vies des non-civilisés.
Si l’on peut dire que nous sommes les relations que nous partageons, ou au moins que ces relations nous façonnent, ou au strict minimum qu’elles influencent qui nous sommes, comment nous agissons, et comment nous percevons, alors l’absence de ce lien fondamental et journalier avec des non-humains sauvages va modifier qui nous sommes, comment nous percevons les créatures sauvages, comment nous percevons notre rôle au sein du monde qui nous entoure, comment nous nous traitons nous-mêmes, comment nous traitons les autres humains, et comment nous traitons ceux qui sont encore sauvages.
***
Beaucoup de zoos de l’antiquité concentraient une quantité phénoménale d’animaux. Les zoos égyptiens détenaient des milliers de singes, des chats sauvages, des antilopes, des hyènes, des gazelles, des bouquetins et des oryx. Quelques historiens des zoos suggèrent qu’en raison de leur caractère sacré, ces créatures étaient bien traitées. Pourtant, ainsi que l’indique Hancocks, « la déification d’une espèce la gratifiait cependant d’un privilège discutable. Utilisés lors de sacrifices rituels, les ibis, faucons et crocodiles sacrés étaient momifiés par centaines de milliers lors de cérémonies sacrées. Les massacres sacrificiels étaient tellement énormes qu’ils ont abouti à l’extermination de ces espèces dans de nombreuses régions d’Égypte ». Les chinois construisirent également d’immenses zoos, tout comme les princes en Inde : Le Moghol Akbar possédait cinq mille éléphants, mille chameaux et mille guépards dans sa collection. Les animaux des zoos ont été élevés comme des animaux de compagnie, des bizarreries, des objets d’étude, comme des distractions, mais surtout — et ceci est aussi vrai de nos jours qu’à l’époque — comme des symboles de prestige et de pouvoir.
Un des plus grands plaisirs que me procure la vie sur cette Terre est la rencontre de mes voisins — les plantes, les animaux et les autres qui vivent ici — alors qu’ils se présentent à moi à leur rythme et selon leurs conditions. Les ours, par exemple, n’étaient pas timides, ils me laissèrent immédiatement voir leurs excréments, puis leurs corps peu de temps après, se tenant sur leurs pattes arrière afin de poser leurs pattes boueuses sur les fenêtres, pour regarder à l’intérieur, ou n’offrant à ma vue, et de manière furtive, que des postérieurs poilus qui disparaissaient rapidement à chaque fois que j’approchais sur un chemin forestier, ou encore marchant lentement comme des fantômes noirs dans le gris profond du point du jour. Bien qu’habitué à leur hardiesse, c’est toujours un cadeau lorsqu’ils se dévoilent encore plus, comme un l’a fait récemment lorsqu’il a nagé juste devant moi dans l’étang. Merles américains, pics flamboyants, colibris et moucherolles se présentent également. Ou plutôt, comme l’ours, ils présentent les parties d’eux-mêmes qu’ils veulent exposer. Je vois souvent des merles, et j’ai vu des fragments de coquilles bleues deux fois, longtemps après que les oisillons soient partis, mais je n’ai jamais vu leurs nids. Pareil pour les autres.
Ces rencontres — ces présentations — et tant d’autres, se font toujours selon les conditions choisies par ceux qui sont sur ces terres depuis bien avant moi : ils choisissent le moment, l’endroit et la durée de nos rencontres. Comme mes voisins humains, et comme mes amis humains, ils me montrent ce qu’ils veulent d’eux-mêmes, quand ils veulent le faire, comme ils veulent le faire, et je les en remercie. Leur demander de m’en montrer plus — et ceci est aussi vrai pour les non-humains que pour les humains — serait excessivement impoli. Ce serait arrogant. Ce serait abusif. Cela détruirait la confiance des autres. Cela détruirait toute la relation potentielle qu’il y aurait pu avoir entre nous. Cela nuirait franchement au bon voisinage.
***
Je suis au zoo. Je suis horrifié. A travers tout le zoo, j’aperçois des consoles aux sommets de petits supports. Des consoles aux designs de dessins animés, clairement destinées aux enfants. Chacune est dotée d’un haut-parleur muni d’un bouton. Lorsque j’appuie sur le bouton, une voix entonne un petit chant : « tous les animaux du zoo t’attendent impatiemment ! » La chansonnette se termine en rappelant aux enfants de s’assurer de « bien s’amuser ! »
***
J’appuie sur le bouton. J’entends la chanson. Je regarde les murs en béton, les espaces vitrés, les douves, les clôtures électriques. Je vois les expressions sur les visages des animaux, si différentes des expressions des nombreux animaux sauvages que j’ai rencontrés. Je remarque également les similitudes entre le regard des prisonniers humains et les yeux de ceux emprisonnés dans les zoos. Si vous vous donniez la peine de regarder, vous verriez les différences, et vous verriez les similitudes.
Le concept central du zoo, et finalement, le concept central de toute cette culture, est que tous « ces autres » ont été placés ici pour nous, qu’ils n’ont aucune existence indépendante de nous ; que les poissons des océans attendent que nous les attrapions ; que les arbres des forêts attendent que nous les abattions ; que les animaux des zoos attendent là pour nous divertir. Peut-être est-ce flatteur, d’un point de vue infantile, de croire que tout est là pour vous servir, mais dans le vrai monde, où de vraies créatures existent et souffrent, c’est assez pathétique de faire comme si personne ne comptait, sauf vous.
***
Malheureusement, nous vivons dans une culture qui souffre de narcissisme, ou pour être plus précis, nous vivons dans un monde qui souffre à cause du narcissisme de cette culture. Dans le livre « la culture du zoo : le livre qui regarde les personnes qui regardent des animaux », Bob Mullan et Garry Marvin demandent: « après tout, pourquoi préserver la vie sauvage ? On pourrait répondre que le monde serait appauvri si les animaux menacés d’extinction étaient autorisés [sic] à disparaître. Mais qui, précisément, serait appauvri ? » Ils répondent ensuite eux-mêmes à leur question, d’une manière qui rend ce narcissisme particulièrement évident: « notre réponse est que le monde des humains serait appauvri, car les animaux sont préservés uniquement pour le bénéfice de l’homme, parce que les êtres humains ont décidé qu’ils voulaient qu’ils vivent pour le bonheur de l’homme. L’idée selon laquelle ils seraient protégés pour eux-mêmes est une idée étrange, car cela impliquerait que les animaux puissent désirer connaître une certaine condition d’existence. Cela n’a de toute façon aucun sens pour l’homme d’imaginer que les animaux puissent avoir une quelconque envie que leur espèce ne perdure ». Il est évident qu’aucun de ces écrivains n’a jamais connu de vrais animaux sauvages, et qu’ils n’ont certainement jamais pris la peine de demander à ces animaux — ni littéralement, ni métaphoriquement parlant — s’ils voulaient survivre. Évidemment, un désintérêt total pour l’autre est une des caractéristiques qui définit le narcissisme.
S’opposent à leurs mots ceux de Bill Frank Jr., Président de la Commission de Pêche Indienne du Nord-Ouest, qui déclare: « si le saumon pouvait parler, il nous demanderait de l’aider à survivre. C’est un problème que nous devons aborder ensemble ». J’ajouterais que les saumons nous parlent déjà, si seulement nous les écoutions.
Mullan et Marvin ajoutent, « les animaux autres que l’homme [sic] ne peuvent pas avoir de sens de l’identité de leur espèce ; ils ne peuvent pas réfléchir sur la nature de leur identité collective; ils ne peuvent pas non plus ressentir qu’il serait bon pour eux de continuer à exister ». Les assertions des auteurs sont insupportables, arrogantes, et absolument nécessaires pour justifier la continuation de l’extermination des non-humains. A nouveau, ils continuent, « le désir pour une espèce de continuer n’est qu’une projection de la part des êtres humains ». Une fois de plus, infondé, insupportable, et nécessaire. Et encore : « la préservation du monde naturel n’est qu’une préservation pour notre propre bénéfice ».
Mullan et Marvin s’opposent également à ce que l’on donne de plus grandes cages aux animaux des zoos, soutenant que, parce qu’ils restent généralement dans un coin de la cage, ils n’ont alors pas besoin d’un plus grand territoire. Ils citent une réplique d’un autre défenseur des zoos selon lequel les guépards se contentent de rester dans un coin de leur cage parce que « contrairement au joggeur, ils ne voient pas l’intérêt de dépenser autant d’énergie ». Ils ajoutent, « en d’autres termes, l’idée qu’ils ont besoin d’espace émane du public, et non de la volonté des animaux ». D’après Dick van Dam, du Zoo Blijdorp de Rotterdam, « les animaux n’ont pas besoin de tant d’espace, mais le public, bien sûr, veut les voir gambader dans de grandes plaines ». Le Professeur H. Hedigger du zoo de Munich, va plus loin: « la cage était autrefois une chose dans laquelle un animal sauvage était enfermé contre son gré, principalement pour l’empêcher de s’échapper. Les animaux sauvages vivaient dans des cages, comme des forçats en prison. Ceci mena à l’idée, largement disparue aujourd’hui, mais qui couve encore chez certaines personnes qui ont très peu de connaissances sur les animaux, que les animaux dans les zoos étaient effectivement des détenus, innocents même, se languissant dans le chagrin, la tristesse et l’amertume de la perte de leur ‘liberté dorée’ et mourant fréquemment d’un mal du pays ». Heddiger nous dit que si nous pensons que les animaux ressentent — et souvenez-vous, les humains sont aussi des animaux — alors, nous devons avoir « très peu de connaissances sur les animaux ». Il continue: « de nos jours, l’idée que les animaux ressemblent de quelque façon à d’innocents forçats est aussi fantasque que de croire que les voix qui sortent des postes de radio émanent de petits bonhommes emprisonnés dans la boîte ». Ainsi, si nous pensons que les animaux ressentent — et, souvenez-vous, les hommes sont aussi des animaux — alors, et selon le Dr. Heddigger, nous devons être fous. Il ajoute enfin: « les animaux sauvages dans les zoos ressemblent plutôt à des propriétaires fonciers. Loin de vouloir s’enfuir et de recouvrer leur liberté, ils se cantonnent à vouloir défendre l’espace qu’ils habitent et à le protéger de toute intrusion ». Est-ce la peine que je commente ceci, ou est-ce que la démence de ce type de raisonnement est aussi évidente pour vous qu’elle l’est pour moi ? De temps à autre, nous pouvons observer ces mêmes justifications, mais formulées autrement. Voici une citation d’un autre gardien de zoo : « Si vous deviez passer un weekend dans un superdome sans contact avec d’autres gens, vous finiriez par vous tapez la tête contre le mur dès le lundi suivant, par ennui. Mais si je vous enfermais dans ce (petit) bureau pour le weekend, et que je vous donnais une radio, des livres, des crayons et ainsi de suite, vous vous occuperiez ».
Je suis sûr que vous voyez les problèmes. D’abord, ces animaux ne sont pas enfermés dans ces cages seulement durant un weekend, mais durant toute leur vie. Ensuite, les options dont nous disposons ne se limitent pas à enfermer ces animaux dans une petite cage ou une grande — dans un bureau ou un superdome. Le gardien de zoo ignore la troisième option : faire sauter le bureau comme le superdome, la petite cage comme la grande, et libérer les animaux. Ou mieux : ne pas les capturer en premier lieu. Ensuite, si les animaux n’ont besoin que d’un petit territoire et qu’ils ne vagabondent pas — ou, comme Hedigger le formule, que les animaux ont perdu « le désir de s’échapper et de regagner leur liberté » — alors il n’y a plus besoin de barreaux, ni de fossés, ni de barrières électriques. Encore une fois, il est clair qu’aucun de ces gardiens de zoo n’a jamais eu de véritable relation avec — et, d’ailleurs, qu’ils n’ont jamais vu — un animal sauvage. N’ont-ils jamais vu des lions de mer surfer, ou des mouettes jouer dans le vent ? N’ont-ils jamais observé de meutes de loups jouer, et des cerfs se dandiner et jouer joyeusement ? N’ont-ils jamais vu d’écureuils courir de haut en bas le long des arbres, se provoquer mutuellement, et provoquer des chiens et d’autres animaux ne pouvant pas grimper pour les attraper ? Lorsque j’élevais des poules, durant les nuits froides, je faisais rentrer les poussins orphelins à l’intérieur. Chaque matin, lorsque je les ramenais dehors, ils sautaient et dansaient. Ils jouaient. Les animaux domestiques, comme les animaux sauvages — et il s’agit d’un droit de naissance que nous partageons tous, y compris nous, les humains, bien que les humains civilisés aient été forcés de l’oublier — passent beaucoup de temps à jouer. Il s’agit d’une large partie de ce que nous faisons. D’une large partie de pourquoi nous sommes là.
***
Je vais dans un zoo. Je vois des animaux exhibés. J’appuie sur le bouton et entends : tous les animaux du zoo sont impatients de te rencontrer. Je rentre à la maison. J’ouvre un journal et tombe sur un article intitulé « la planète des animaux: de la célèbre foire aux chameaux en Inde aux féroces varans de Komodo indonésiens — Le monde entier est un zoo ». Et le sous-titre, en gros caractères gras: « le monde des animaux attend ». Qui ? Vous, bien sûr. Je repose le journal et allume mon PC. Je vais sur un site porno. Je vois des femmes exhibées. Je clique sur ma souris, et je lis : « toutes ces dames adorent se déshabiller devant la caméra et s’amusent beaucoup durant ces prises de vues, qui vous sont accessibles sans aucune censure ». […]
Exhiber tous ces « autres » n’est pas suffisant. Nous devons nous convaincre qu’ils sont les acteurs désespérément volontaires de leur propre dégradation, que nous ne les exploitons pas mais leur faisons une faveur. Nous secourons les ours du monde sauvage, nous sauvons des orphelins d’une condamnation à mort. Les animaux des zoos sont tellement heureux que nous avons besoin de cages afin d’empêcher ceux qui sont à l’extérieur de se précipiter à l’intérieur. Les animaux sont riches, ce sont même des propriétaires vivant leurs vies dans un luxe oisif. Je clique sur ma souris d’ordinateur et je lis, « il y a maintenant une douzaine de gorilles et une douzaine de chimpanzés qui vivent dans ce nouveau morceau de paradis des singes. Ils veulent tous te rencontrer ».
***
On dit souvent que l’une des premières fonctions positives des zoos est l’éducation. La fin typique d’un livre sur les zoos est un plaidoyer écrit dans un langage lyrique, expliquant que parce que la terre est devenue un champ de bataille, et puisque les animaux perdent la bataille et la guerre, les zoos sont alors le dernier espoir d’un monde sauvage assiégé. Ce n’est qu’en exposant le plein potentiel éducatif des zoos que suffisamment de personnes se soucieront du monde sauvage pour que nous cessions de détruire la planète. Le défi des zoos, selon un autre passage type, est « de permettre aux animaux vivants d’inspirer l’émerveillement et l’admiration du monde naturel ; de nous apprendre cette place de l’animal dans le cosmos et de mettre en lumière la toile enchevêtrée et fragile de la vie qui le nourrit ; c’est une porte ouverte à la préservation pour des millions de personnes qui veulent aider à sauver cette planète et les incroyables créatures qu’elle abrite. Pour enrichir, illuminer, et inspirer les personnes qui s’en soucient, afin qu’à travers le pouvoir de la volonté d’un très grand nombre, nous sauvions le scarabée, l’escargot, et l’alligator, ainsi que le panda, le rhinocéros et le condor ».
Examinons cela. L’usage du mot « permettre » par l’auteure, Vicki Crocke, sous-entend toujours et encore cette même vieille implication volontaire de la part des encagés, et ignore le fait que leur incarcération est imposée par la force : nous devons capturer et emprisonner ces autres afin que nous puissions leur permettre de nous enseigner. « Permettre » serait tout à fait approprié si nous parlions d’animaux sauvages dans des circonstances sauvages, qui se présenteraient à nous en tant que professeurs. Au sein de nombreuses cosmologies indigènes, les créatures sauvages sont nos premiers enseignants. Je pense souvent aux mots de Brave Buffalo, « J’ai remarqué dans ma vie que tous les hommes ont des préférences pour un animal, un arbre, une plante ou un endroit spécifique de la Terre. Si les hommes faisaient plus attention à ces préférences et cherchaient à faire ce qu’ils peuvent pour se comporter dignement vis-à-vis de cette préférence, ils feraient peut-être des rêves qui purifieraient leurs vies. Il faut laisser l’homme choisir et étudier son animal favori, apprendre ses habitudes. Le laisser apprendre ses bruits et ses déplacements. Les animaux veulent communiquer avec les hommes, mais Wkan’Taka [Le Grand Esprit] ne souhaite pas leur permettre de le faire de manière directe — les hommes doivent faire le principal afin de garantir cette compréhension ».
Et, selon Vicki Croke, que nous apprennent ces animaux incarcérés — oh, pardon, ces propriétaires fonciers ? Ils vont « nous inspirer l’émerveillement et l’admiration du monde naturel ».
Êtes-vous déjà allé au zoo ? Les zoos sont constitués d’animaux en cages — oh, pardon, en habitats, rangées après rangées, sentiers après sentiers. Les zoos sont, au mieux, de mauvaises simulations du monde naturel. Ainsi, ce qui peut être transmis est, au mieux, un sentiment d’admiration envers l’intelligence de ceux qui tentent de concevoir ces simulations et une sorte d’étonnement malaisé à l’idée que quiconque essaie (pourquoi essayer — et misérablement échouer — de reproduire la nature lorsque la nature le fait gratuitement ?). Et avez-vous vus les gens dans les zoos ? Le grizzly qui faisait les cent pas ne provoque aucune réaction chez ceux qui lui passent devant, et certainement pas l’émerveillement et l’admiration. Et quels sentiments des hippopotames à la dérive dans un réservoir de béton plein d’eau et d’excréments inspirent-ils ? Et les éléphants enchainés ? Et la girafe solitaire ? L’émerveillement et l’admiration seraient complètement inappropriés, à moins que cela ne soit à la vue de la résilience de ces créatures face à toutes ces horreurs.
Les zoos ne m’inspirent pas un sentiment « d’émerveillement et d’admiration ». Ils m’inspirent un sentiment de solitude et de profond chagrin. Je ne vois aucun émerveillement ni aucune admiration sur les visages des directeurs de zoos. J’entends des enfants rire des animaux. Non pas ce « doux son des rires d’enfants » dont on lit si souvent la description dans de mauvais poèmes, mais le rire moqueur de la cour d’école, le rire de la malchance de l’autre, le rire qui donne de la voix au même mépris qui se manifeste dans les titres désinvoltes des journaux et dans les blagues des magazines comme Jogging Man. Je vois des mères avec leurs jeunes enfants, riant avec eux en montrant du doigt ces animaux stupides, se moquant du gros orang-outan, se moquant du loup qui fait les cents pas, faisant des grimaces effrayantes au serpent, ignorant l’ours qui fait les cents pas, se moquant du fourmilier qui fait des allers-retours et des allers-retours, toujours et encore. Et ces femmes avec leurs poussettes, avec leurs jeunes enfants qui chouinent pour de la barbe-à-papa, qui chouinent pour avoir des ours en peluche, ne s’arrêtent jamais de marcher, ne s’arrêtent jamais de parler, ne s’arrêtent jamais de pointer du doigt et de rire. Ils pénètrent le pavillon des singes. Ils hurlent sur ces idiots de singes, ces chimpanzés stupides qui se mettent les doigts dans le nez et qui regardent fixement les femmes et les enfants, à travers la vitre. Les enfants rient et tapent sur la vitre. Ils se collent tout près, et dévisagent à leur tour l’animal de l’autre côté. Lui font des grimaces. Puis se détournent. J’entends encore les mères hurler, et dire : « oh, regarde, le singe fait une petite crotte ! » Je ferme les yeux, et me retrouve une fois de plus agrippé à la rambarde. Les enfants rient et hurlent. Les mères aux voix stridentes s’exclament à nouveau, « oh, regarde, le singe étale sa petite crotte sur la vitre ». Les femmes et les enfants rient et crient.
Je pense, « ne sais-tu pas ce que ce chimpanzé vient juste de te dire ? Es-tu tellement déconnectée que tu ne remarques même pas lorsque tu as été insultée ? »
Que sont en train d’apprendre ces femmes et ces enfants ? Quel « émerveillement et admiration » permettent-ils aux animaux d’inspirer ?
Croke continue, et nous dit du but des zoos qu’il est « de nous apprendre cette place de l’animal dans le cosmos et de mettre en lumière la toile enchevêtrée et fragile de la vie qui le nourrit ». Cela n’a pas de sens. Les zoos nous apprennent que la place d’un hippopotame est dans une piscine de béton remplie de merde, que celle d’un singe est derrière une fenêtre vitrée afin qu’il ne puisse pas vous balancer sa merde au visage — ce qu’il adorerait certainement faire à ce stade — et que la place d’un grizzly est dans un « habitat » de 900 mètres carrés. Comment un zoo peut-il nous apprendre la place d’un animal dans le cosmos, quand la présence même de cette créature dans un zoo implique qu’elle ou ses aïeux aient été retirés de force de cette place légitime. Et comment un zoo peut-il illuminer une toile enchevêtrée et fragile, lorsque toutes les parties la composant sont séparées et mises en cage ? La toile est faite des relations entre les différents animaux, plantes, sols et climats, et ne peut être simulée dans une boîte de béton, qu’importent les « enrichissements » ajoutés.
Vicki Croke n’est pas la seule. David Hancoks utilise un langage tout aussi messianique pour promouvoir la notion selon laquelle les zoos sont le dernier espoir de la nature : « les zoos possèdent le merveilleux potentiel de pouvoir développer une population citoyenne concernée, éveillée, enthousiasmée, stimulée, attentive, et empathique. Les zoos peuvent cultiver une sensibilité environnementale chez leurs centaines de millions de clients. Une telle populace peut alors souhaiter vivre plus doucement sur la terre, être plus attentive vis-à-vis de l’utilisation des ressources naturelles du monde, et choisir de voter pour des politiciens qui se soucient des habitants sauvages de la Terre et de la santé de ses derniers endroits sauvages. Aider à sauver la vie sauvage, travailler à améliorer la santé de la planète, et encourager la sensibilisation de la populace : voici les objectifs des nouveaux zoos ».
Nous pourrions examiner cette déclaration de la même manière que celle de Vicki Croke, et y trouver les mêmes suppositions infondées et la même pensée magique, mais il serait plus efficace encore que vous vous rendiez dans un zoo afin d’observer vous-mêmes leurs clients.
Même si on les croyait sur parole quant au potentiel éducatif des zoos, des études ont démontré, les unes après les autres, qu’ils ont misérablement échoué en cela. Comme un auteur nous le dit: « une étude sur la durée d’observation au Park de Regent, en 1985, nous révèle que les spectateurs se tiennent en moyenne 46 secondes devant l’enclos des singes, et passent 32 minutes dans un pavillon contenant une centaine de cages. Plutôt que de témoigner d’un examen approfondi, cela nous fait plutôt penser à la vitesse à laquelle les programmes télé, et même les pièces des musées sont ‘consommées’. » Ces 46 secondes incluent le temps passé à lire — ou plutôt à survoler — les informations affichées à propos des animaux. De plus, alors que 80% des visiteurs de zoos affirment y avoir appris quelque chose, des études ont montré que même après leur visite, ils demeurent moins « sensibilisés à la nécessité de respecter la nature » que les randonneurs. Toutes ces enquêtes nous révèlent que même lorsque les visiteurs sont encore dans le zoo, se tenant juste devant les animaux en question, ils échouent constamment même sur des questions de nomenclature rudimentaire : ils appellent encore « singes » les gibbons et les orangs-outans ; « buses », les vautours ; « paons », les casoars ; « lions », les tigres ; « castors », les loutres, et ainsi de suite.
Voici le commentaire de Peter Batten [ancien directeur du zoo de San Jose, aux USA, qui a ensuite écrit un livre sur les zoos, intitulé « Trophées vivants : un regard choc sur les zoos des États-Unis »] à propos de la valeur éducative des zoos : « L’idée que quiconque retire des bénéfices sur le long terme d’avoir observé des animaux sauvages d’autres pays dans des cages qui inhibent leur comportement naturel devrait être étudiée sans préjugé. Devrait-on apprendre que le chimpanzé, par exemple, est un humanoïde névrosé qui reçoit sa nourriture des humains, et qui pique des crises de colère et jette ses excréments le cas échéant ? Ou que l’orang-outan, qui, par nature, descend rarement sur le sol doux de la forêt, n’est qu’un tas de fourrure rouge pathétique dans le coin d’une cellule carrelée ? Le lion de mer de Californie, vif et grégaire, devrait-il être représenté par un animal à moitié aveuglé par l’eau non-salée et sale dans laquelle il passe sa vie à mendier pour des poissons pourris ? »
Tout cela dit, je pense que les zoos parviennent largement à apprendre des choses à leurs visiteurs, concernant les non-humains. Mais la question demeure : qu’enseignent-ils ?
Bien qu’il soit exact, comme Berger l’a écrit, que « la capture des animaux était une preuve symbolique de la conquête des terres exotiques lointaines », et qu’il est vrai que les zoos sont des symboles de richesse et de pouvoir, nous ne devons jamais oublier qu’il y a bien plus en jeu que de pâles symboles, surtout pour ceux qui sont les plus intimement impliqués. A l’époque de l’Empire Romain, on préférait traditionnellement les fosses et les pièges pour capturer la plupart des animaux. Les blessures étaient fréquentes et souvent fatales. Même les animaux qui n’étaient pas physiquement blessés n’en sortaient pas indemnes. En plus de perdre leur liberté pour toujours, manifestement, Baratay et Hardouin-Fugier rapportent que « le choc de la capture est tel que, selon certains dresseurs, ‘un félin est presque fou une fois ramené’ ». Historiquement, environ 50% des animaux mourraient sur les bateaux à destination de l’Europe ou de l’Amérique. Baratay et Hardouin-Fugier écrivent que « Les morts avant embarcation ne sont même pas calculables. Pour la plupart des singes et pour d’autres animaux, les morts de leurs mères, et, par conséquent, de leurs descendants, doivent aussi être comptées. James Fisher, assistant directeur du zoo de Londres, estime que la capture d’un seul orang-outan en élimine quatre dans le monde naturel, dont trois mères potentielles. Domalain estime à 10 le nombre d’animaux tués pour chaque animal que l’on peut voir dans un zoo. Même au 20ème siècle, le taux de mortalité par transport aérien continuaient à être élevés : entre 1988 et 1991, il était d’entre 10 et 37% pour les babouins et les singes d’Afrique aux queues longues, de 10% chez ceux en provenance des Philippines et de 18 à 54% chez ceux en provenance d’Indonésie ».
La méthode traditionnelle de capture de nombreuses espèces sociales, notamment les éléphants, les gorilles, les chimpanzés et bien d’autres, était — et demeure — de tuer les mères. A propos des éléphants, on disait: « la seule façon de capturer un animal vivant était de tuer les femelles allaitantes et les chefs du troupeau. Le récit de l’expédition Tornblad au Kenya parle de l’abattage des girafes adultes qui permit la capture d’un girafon, qui fut aussitôt accueilli dans le groupe, soigné et à qui fut donné le nom de ‘Rosalie’. Hagenbeck s’est retrouvé ‘trop souvent obligé de tuer’ des éléphants qui protégeaient leurs petits en se servant de leurs corps comme de boucliers. »
Continuez simplement à vous répéter que ce ne sont que des animaux. Qu’ils ne ressentent pas. Qu’ils s’en fichent. Qu’ils n’éprouvent aucun chagrin. Que les mères et les pères n’aiment pas leurs petits. Que les petits n’aiment pas leurs parents. Continuez à répéter que de croire que les animaux pourraient désirer un certain type de vie est un concept étrange.
Je pense qu’il vaut mieux décrire la capture des animaux des zoos à l’aide des mots des humains les plus directement impliqués. Je ne peux faire mieux qu’eux.
Hans Dominik était un allemand qui vivait en Afrique au début du 20ème siècle. Il capturait et vendait beaucoup d’animaux différents, y compris l’animal humain. Le voici qui décrit la capture d’éléphants pour les zoos : « Les animaux étaient peu actifs. Les cris d’humains au travail qui transperçaient le calme de la forêt semblaient à peine les déranger. Un mâle adulte se tenait à l’écart, et arrachait des branches avec sa trompe afin d’en manger les feuilles. Plus près de nous, une femelle caressait amoureusement son enfant, qui était à peine plus gros qu’un porc, et qui se tenait entre ses pattes, avec sa trompe. Quelques animaux mangeaient — arrachant ensemble des herbes basses et utilisant leurs trompes comme des faux — la plupart semblaient endormis… Nous paraissions si petits, si insignifiants comparés aux puissants animaux du puissant monde sauvage ».
Comment cela se déroulait-il ? « Vous prouvez votre valeur en gardant un animal captif ; êtes-vous vraiment plus puissant si vous le tuez ?«
Cette nuit-là, Dominik et ses domestiques construisirent une barrière pour empêcher que les animaux ne s’échappent. La « chasse » commença le matin suivant. « L’un après l’autre, alors qu’ils attrapaient quelque bout de verdure ci et là, les éléphants s’approchèrent de nous lentement. Les crans de sûretés furent ôtés. ‘Toi, le deuxième’, ai-je murmuré à Zampa. Les animaux étaient prêts. J’ai fait feu sur l’oreille de l’animal le plus proche. Au moment du bruit cassant, l’éléphant leva sa trompe en l’air et émit un puissant son. Sa courte queue s’étendit, il tourna sur lui-même comme une toupie. A ce moment-là, Zampa fit feu. Proche de moi, le second animal s’effondra à genoux, puis se releva rapidement et suivi le mâle de tête beuglant et sanguinolent, qui se dirigeait vers la colline ».
Dominik suivit l’animal blessé, en continuant à lui tirer dessus tandis qu’il le suivait. Il les retrouva. « Un des animaux était étendu ici ; apparemment la colonne vertébrale avait été touchée parce que l’éléphant ne s’était écroulé que sur son arrière-train, et était en position assise. Tel des colonnes, ses pattes avant s’élevait depuis le sol, sa tête et sa trompe se balançaient de droite à gauche : il émit un gémissement étouffé, des morceaux de sang coulaient depuis son flanc, preuve que les poumons étaient aussi touchés. L’autre se tenait près de lui, immobile, à l’exception de sa trompe. Il soufflait souvent, il se projetait de la terre sur lui avec sa trompe. Notre approche ne sembla pas les perturber. Nous nous glissèrent près d’eux. J’avais l’œil de ce géant assis juste au bout de mon fusil, lorsque, derrière moi, Zampa fit feu. L’éléphant qui se tenait debout barrit bruyamment. A mon tour, j’ouvris le feu, et il s’écroula sur place. L’autre éléphant se tenait toujours debout ; finalement, au premier coup de la deuxième chambre de mon fusil, il s’effondra. L’un à côté de l’autre, les deux géants baignaient dans une mare de sang. Amba et Balla étaient déjà là ; avec leurs machettes aiguisées ils coupèrent leurs trompes, qui étaient épaisses comme la moitié d’un homme. Les animaux respiraient encore. Comme d’une fontaine, le sang rouge jaillissait des énormes artères et aspergeait nos vêtements tandis que nous nous tenions aux côtés des animaux, à examiner nos armes et à discuter de la suite de la chasse ».
Dans son livre crucial, Savages and Beasts (non traduit, en français : Les sauvages et les bêtes), Nigel Rothfels décrit la suite de l’histoire de Dominik : « la fascination macabrement détaillée qui transparaît dans cette histoire continue au fil de la chasse. Bientôt Dominik fit la rencontre d’une femelle et de son petit ; après plusieurs coups de feu, affreusement décrits, la femelle fut achevée par un tir dans l’œil gauche. Le petit fut attaché à un arbre, et se mit à ‘retourner le sol avec ses petites défenses, à brailler et à gémir, à charger en arrière, à se tenir sur sa tête, et à baver de rage tandis que des yeux injectés de sang ressortaient de son visage’. Trois autres petits furent bientôt capturés, l’un d’eux mourut d’asphyxie après que sa trompe ait été attachée entre ses jambes à ses pattes arrières ce qui fit qu’il ‘respira avec difficulté et s’étendit sur le sol comme un gros sac gris’. Un autre petit mourut durant la nuit des blessures infligées au cours de la capture, mais Dominik parvint à garder deux petits de la troupe et en ajouta peu après trois autres à sa collection. Deux moururent un mois après, mais les trois restants semblaient prospérer [sic] dans leur nouvel environnement, et l’un d’eux, via Hagenbeck, fut transféré au zoo de Berlin, où des milliers de berlinois purent admirer cette nouvelle acquisition en provenance des colonies ».
Comment cela se déroulait-il ? Tous les animaux du zoo t’attendent impatiemment.
Heinrich Leutemann clarifie les priorités de ceux qui capturent les animaux pour les zoos: « pour le négociant d’animaux, la méthode de capture est, du point de vue des affaires, une question triviale ». Il donne des exemples: « les lions, sans exception, sont capturés petits après que leurs mères aient été tuées, c’est la même chose pour les tigres, parce que ces animaux, lorsqu’ils sont attrapés adultes, dans des trappes ou des fosses, sont trop puissants et intenables, et meurent généralement en résistant. Les grands singes anthropoïdes ne peuvent être capturés — à quelques exceptions près — que très jeunes aux côtés de leurs mères mortes. C’est le même scénario avec presque tous les animaux; durant le processus, les girafes et les antilopes, par exemple, lorsqu’elles sont chassées, abandonnent tout simplement les petits qui sont restés à la traîne, alors que la mère éléphant défend son éléphanteau et doit (sic) par conséquent, être tuée. Ce qui est également le cas des hippopotames. Et celui des rhinocéros: les petits sont arrachés aux adultes, qui (sic), par conséquent, se font généralement tuer ».
L’éléphant le plus connu du XIX siècle était peut-être Jumbo. Il fut capturé de la même manière. Un chasseur, Hermann Schomburgk, a abattu sa mère. Il le décrit lui-même: « elle s’est écroulée en arrière, me laissant une chance de sauter sur le côté et de lui porter un coup fatal, après quoi, elle mourut immédiatement. Obéissant aux lois de la nature, le jeune animal est resté à côté de sa mère… Jusqu’à ce que mes hommes arrivent, j’ai observé comment ce pitoyable petit bébé n’arrêtait pas de courir autour de sa mère en lui donnant des coups avec sa trompe comme s’il voulait la réveiller afin qu’ils s’enfuient ».
***
Qu’apprenons-nous vraiment des zoos ? Qu’apprenons-nous en regardant ces animaux pathétiques, abattus, en colère ou devenus fous ? Qu’apprenons-nous au-delà des banalités affichées sur les écriteaux devant les barreaux, les douves ou les clôtures électrifiées ?
Nous apprenons que les humains ne sont pas des animaux. Nous apprenons que nous, sommes ici, et eux, là-bas.
Nous apprenons qu’ils sont là pour nous: pour notre plaisir, notre divertissement, notre éducation: pour « nous ». Nous apprenons qu’ils n’ont aucune existence indépendante des nôtres.
Nous apprenons que notre monde est sans limite, mais que le leur est limité, contraint, étriqué.
Nous apprenons que nous sommes plus futés qu’eux, autrement ils pourraient nous tromper et s’échapper. Ou, peut-être, qu’ils ne veulent pas s’enfuir, que leur ravitaillement en mauvaise nourriture — les grizzlys du zoo de San Francisco sont aujourd’hui nourris avec de la nourriture industrielle pour chien — et que leur abri en béton à l’intérieur d’une cage ont davantage d’importance que la liberté. (L’importance que des humains tirent de tout ceci des leçons vis-à-vis de leur propre vie ne doit pas être négligée).
Nous apprenons que nous sommes plus puissants qu’eux, sinon nous ne pourrions pas les confiner ainsi. Nous apprenons qu’il est acceptable pour le technologiquement puissant d’enfermer le moins technologiquement puissant (une fois encore, l’importance de faire en sorte que des humains technologiquement moins puissants intègrent ce message ne doit pas être négligée).
Nous apprenons que chacun de nous, peu importe l’impuissance que nous ressentons dans nos vies, est plus puissant que le plus imposant des éléphants ou des ours polaires. Pourquoi ? Parce que nous pouvons aller et venir.
Nous apprenons que leurs « habitats » ne sont pas les forêts, les plaines, les déserts, les rivières, les montagnes et les mers préservés, mais les cages et rochers en béton avec des troncs d’arbres morts.
Nous apprenons qu’une créature extraite de son habitat demeure une créature. Nous voyons un lion de mer dans une piscine en béton, et croyons qu’il s’agit encore d’un lion de mer. Mais ce n’est pas le cas. C’est faux. Nous ne devrions jamais laisser les zoologues définir pour nous ce qu’est ou qui est, un animal.
Les zoos nous enseignent que les animaux sont de la viande et des os dans un sac de peau. Vous pourriez mettre un carcajou dans des cages de plus en plus petites, jusqu’à avoir une cage de la taille précise du carcajou, et vous auriez quand même, d’après ce que les zoos nous enseignent implicitement, un carcajou.
Les zoos nous enseignent que les animaux sont comme des éléments d’une machine : séparables, remplaçables, interchangeables. Ils nous enseignent qu’il n’y a pas de toile de vie, que vous pouvez extraire un élément, le mettre dans une boîte, et toujours être en présence de cet élément. Mais tout cela est faux.
Les zoos nous enseignent implicitement que les animaux ont besoin d’être gérés, qu’ils ne peuvent survivre sans nous. Qu’ils sont nos tributaires, pas nos enseignants, nos voisins, nos supérieurs, nos égaux, nos amis, nos dieux. Qu’ils sont à nous. Que nous devons assumer la version inter-espèces du « fardeau de l’homme blanc », et par la bonté de nos cœurs, bénévolement contrôler leurs vies. Que nous devons les « sauver du monde sauvage ».
Voici la véritable leçon que nous enseignent les zoos, la leçon universelle, la leçon suprême, et, en fait, la seule qui compte vraiment : un abîme immense sépare les humains des autres animaux. Il est plus large que le plus large des fossés, plus solide que les barreaux les plus résistants, plus sûr que les plus létales des clôtures électriques. Nous sommes ici. Ils sont là-bas. Nous sommes spéciaux. Nous sommes à part.
***
Les zoos impliquent au moins quatre péchés impardonnables. Premièrement, ils détruisent la vie de ceux qu’ils enferment. Deuxièmement, ils détruisent notre compréhension de qui sont les animaux et de ce qu’est un habitat. Troisièmement, ils détruisent notre compréhension de qui et de ce que nous sommes vraiment. Quatrièmement, ils détruisent le potentiel des relations mutuelles, non seulement avec ces animaux encagés mais aussi avec ceux qui sont encore sauvages.
Les zoos — comme la pornographie, la science — remplacent les relations profondes basées sur le respect mutuel et le don par des relations superficielles basées sur la hiérarchie, basées sur la « domination et la soumission », basées sur un consommateur séparé manipulant et observant un « autre » ayant donné, ou pas, son accord pour être soumis à cette observation.
Pensez à une image pornographique. Même dans les cas où les femmes sont payées et posent volontairement, elles ne m’ont pas donné la permission de voir leurs corps — ou plutôt les images de leurs corps — ici et maintenant. Si j’ai une photo, je l’ai pour toujours, même si la femme souhaite par la suite retirer cette permission. Il s’agit de l’opposé d’une relation, où la femme peut se présenter à moi ici et maintenant, et à ce moment, et à cet autre, à la fois selon sa volonté et selon la mienne (et, bien sûr, je peux aussi me présenter à elle ici et maintenant, et à ce moment, et à cet autre selon ma volonté et selon la sienne). Ce qui, dans le dernier cas, est un don, moment après moment, devient, dans le premier cas, une propriété, dont je peux faire ce que je veux. Ceci est vrai, bien sûr, de toutes les photographies.
Et des zoos. Je ne contrôle pas, et ne peux pas contrôler l’ours dont je partage l’habitat, afin qu’il se présente à moi. Ni les geais du Canada, ni les salamandres de Californie, ni les limaces. Ils possèdent leur volonté propre et indépendante.
Tout est bien pire que ce que je présente. Les zoos — comme la pornographie, la science, comme d’autres reproductions toxiques — peuvent faire oublier aux humains ces besoins originels en relation, leur faire oublier que l’échange mutuel est possible, que les relations profondes existent, et peuvent leur faire croire que le « contrôle » de l’autre est quelque chose de naturel, et de désirable.
La pornographie se saisit du besoin relationnel créatif lié à la sexualité avec des partenaires consentants — et l’intimité que cela implique — et le réduit à une relation entre un observateur et un observé. La science se saisit du besoin relationnel créatif en compréhension et en obtention de savoirs et le réduit à la même dynamique : l’observateur et l’observé ; le dominant et le dominé ; le sujet et l’objet. Les zoos se saisissent du besoin créatif de relations avec des non-humains sauvages et le réduit à une « expérience de la nature » qui consiste à passer quelques moments à regarder — ou simplement à déambuler devant — des ours fous et des chimpanzés en colère dans des cages de béton.
Pire. L’incarcération des animaux dans les zoos relève autant de la rencontre sauvage que le viol ne relève de l’amour. L’une comme l’autre requièrent de la coercition, limitent la liberté de la victime, émergent de, manifestent et renforcent la prérogative autoproclamée d’accès total à la victime de la part de l’auteur. L’une comme l’autre détruisent le potentiel d’une relation intime entre la victime et l’auteur. Ils pervertissent la notion de ce qu’est une relation. Ils se basent sur la dyade de dominance et de soumission. Ils empêchent toute possibilité réelle d’une compréhension mutuelle et volontaire de l’autre.
Tandis que la vraie rencontre avec des animaux non-humains sauvages, comme l’amour, sont des danses entre participants volontaires, qui donnent ce qu’ils veulent, comme ils le veulent, quand ils le veulent. Ils inspirent l’intimité présente et future, la compréhension présente et future de l’autre et de soi. Ils nourrissent ceux qui sont impliqués. Ils approfondissent ce que nous sommes.
Plus tôt dans ce livre, des gardiens de zoos posaient la question « que veulent les grizzlys ? » Leur question, cependant, était une reproduction toxique d’une vraie question. Il s’agissait d’un artifice rhétorique visant à leur fournir une réponse prédéterminée. Il s’agissait d’un mensonge, visant à dissimuler leur véritable question, qui est « que veulent les grizzlys, étant donné que nous, les gardiens de zoos, allons contrôler leurs vies pour toujours, et les garderons pour toujours dans des petites cages que nous qualifierons d’habitat ? »
Reposons cette question, sincèrement, cette fois : que veulent les grizzlys ? Demandons-nous ensuite, que veulent les saumons ? Que veulent les chouettes tachetées ? Que veulent les babouins hamadryas ? Que veulent les séquoias ? Que veulent les châtaigniers américains ?
Tout ceci nous mène à la question suivante : comment savoir ce qu’ils veulent ? Une fois que nous poserons ces questions — que veulent-ils, et comment savoir ce qu’ils veulent ? — que nous les poserons honnêtement, que nous les poserons sans préjugés, que nous les poserons non pas comme une excuse visant à les incarcérer et à les exploiter, que nous les poserons non pas en tant que « seigneurs de la Terre » mais en tant que voisins, et amis, que nous les poserons respectueusement, que nous les poserons à nos anciens, à ceux qui vivent sur les territoires que nous partageons depuis bien plus longtemps que nous, que nous les poserons non pas à propos de quelques individus mais à propos de familles, de clans, de communautés, et de terroirs, que nous les poserons comme si leurs vies et les nôtres en dépendaient (parce qu’elles en dépendent), nous nous rendrons compte — bientôt — que tout ce que nous savons va changer. Le vacarme de la chambre d’écho diminuera, les hallucinations et les illusions de grandeurs induites par la séparation s’estomperont. La solitude — dévastatrice, ruinant l’âme, et engourdissant le cœur — se brisera, s’effondrera et sera emportée par une marée de nouveaux voisins, présents depuis le début, jusqu’à ce qu’elle ne soit plus une peine, jusqu’à ne plus être ce présent qui consume mais un souvenir d’un traumatisme passé, jusqu’à devenir un conte à l’attention des générations futures, qui ne comprendront pas comment quiconque put un jour être insensé au point de ne pas parvenir à écouter.
Traduction: Emmanuelle Dupierris & Nicolas Casaux
Édition & Révision: Héléna Delaunay et Nicolas Casaux
Filed in Français