"If we wish to stop the atrocities, we need merely to step away from the isolation. There is a whole world waiting for us, ready to welcome us home." Derrick Jensen
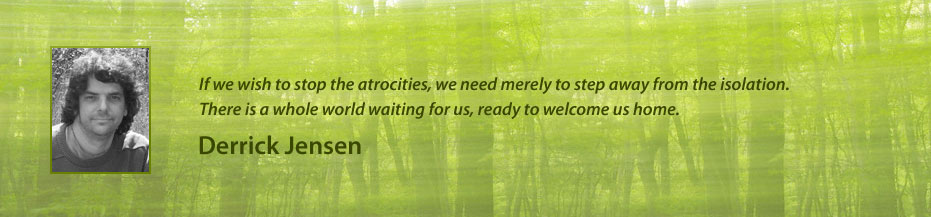
-
See the Archives
- March 2023
- September 2019
- August 2019
- March 2019
- October 2018
- September 2018
- August 2018
- July 2018
- June 2018
- May 2018
- April 2018
- March 2018
- February 2018
- January 2018
- December 2017
- November 2017
- October 2017
- September 2017
- August 2017
- July 2017
- May 2017
- April 2017
- March 2017
- February 2017
- January 2017
- December 2016
- October 2016
- September 2016
- August 2016
- March 2016
- January 2016
- December 2015
- November 2015
- August 2015
- July 2015
- June 2015
- March 2015
- February 2015
- January 2015
- November 2014
- October 2014
- August 2014
- May 2014
- April 2014
- March 2014
- January 2014
- December 2013
- November 2013
- October 2013
- September 2013
- July 2013
- June 2013
- May 2013
- March 2013
- January 2013
- September 2012
- July 2012
- May 2012
- February 2012
- January 2012
- December 2011
- September 2011
- August 2011
- July 2011
- May 2011
- March 2011
- February 2011
- January 2011
- December 2010
- November 2010
- September 2010
- July 2010
- June 2010
- May 2010
- March 2010
- January 2010
- December 2009
- November 2009
- October 2009
- September 2009
- July 2009
- May 2009
- February 2009
- January 2009
- November 2008
- September 2008
- August 2008
- June 2008
- February 2008
- December 2007
- November 2007
- October 2007
- June 2007
- May 2007
- April 2007
- March 2007
- January 2007
- November 2006
- October 2006
- September 2006
- August 2006
- July 2006
- June 2006
- May 2006
- January 2006
- September 2005
- July 2005
- April 2005
- December 2004
- September 2004
- July 2004
- May 2004
- March 2004
- February 2004
- November 2003
- October 2003
- July 2003
- June 2003
- May 2003
- March 2003
- February 2003
- November 2002
- July 2002
- June 2002
- May 2002
- March 2002
- February 2002
- December 2001
- October 2001
- August 2001
- July 2001
- April 2001
- March 2001
- February 2001
- December 2000
- November 2000
- October 2000
- September 2000
- July 2000
- June 2000
- May 2000
- April 2000
- March 2000
- January 2000
- December 1999
- November 1999
- September 1999
- August 1999
- March 1999
- October 1998
- September 1998
- August 1998
- May 1998
- November 1997
- July 1997
- April 1997
- January 1997
- October 1996
- May 1996
- April 1996
- October 1995
- March 1995
- April 1991
- Filter by Category
Effondrements
June 15th, 2006(…) Une amie m’a téléphoné, Roianne Ahn, une femme intelligente et suffisamment obstinée pour que même un DEA en psychologie n’ait pas biaisé sa façon de voir comment les gens pensent et agissent. « Cela n’a jamais cessé de me stupéfier, » a-t-elle dit, « qu’il faille des experts pour nous convaincre de ce que nous savons déjà. »
Ce n’était pas la réponse à laquelle je m’attendais.
Elle continuait: « C’est un de mes rôles en tant que thérapeute. Je ne fais qu’écouter et refléter aux patients les choses qu’ils connaissent, mais ils n’ont pas assez confiance pour y croire jusqu’à ce qu’un expert extérieur le leur dise. »
« Penses-tu que les gens vont écouter ces scientifiques?ndlt »
« Cela dépend à quel point ils sont dans le déni. Mais le facteur décisif est que ce qu’ils décrivent n’est pas une grosse surprise. C’est ce qui se passe quand une personne est sous le stress: elle prend sur elle jusqu’à ce qu’elle s’écroule. C’est ce qui arrive dans les relations avec les autres. Ça arrive dans les familles. Ça arrive dans les communautés. Naturellement ça serait vrai dans ces cas-là aussi, à grande échelle. »
« Qu’entends-tu par là? »
« Nous travaillons du mieux que nous le pouvons, souvent au-delà de nos capacités, pour maintenir une stabilité, mais quand la pression est trop forte, il faut que ça casse. Nous nous effondrons. Parfois c’est mauvais, parfois c’est bien. »
Il y eut un silence pendant lequel je pensais au fait que certains effondrements ne sont pas nécessaires – quand des prisonniers craquent sous la torture, le démantèlement systématique de l’estime de soi sous le broyage d’un régime parental ou sentimental abusif, l’apocalypse écologique qui est en cours – alors que d’autres peuvent être salutaires.
Elle continuait: « La raison pour laquelle les gens essaient de maintenir des structures curatives qui peuvent les rendre heureux est évidente. Elle est moins évidente quand nous, et je m’y inclus moi-même, essayons de maintenir des systèmes qui rendent les gens misérables. Nous sommes tous familiers avec la notion que beaucoup d’accrocs doivent toucher le fond avant de changer, même quand leur dépendance est en train de les tuer. »
J’ai demandé: « Quand penses-tu que la culture changera? »
« Cette culture est clairement dépendante de la civilisation » a-t-elle dit. « Donc je pense que la réponse à cette question en pose une autre: jusqu’où cela ira avant de toucher le fond? »
* * *
J’ai parlé à une autre amie de tout cela. C’était tard dans la nuit. Le vent soufflait dehors. L’ordinateur était éteint. Nous entendions le vent. Cette amie, un excellent penseur et écrivain, avait habité à New York, et portait une certaine estime non seulement pour cette grande villes, mais aussi pour les grandes villes en général. Elle éprouvait à la fois de la sympathie et de l’exaspération envers moi et ce que je disais. Après avoir discuté des heures, elle demanda, assez raisonnablement, « De quel droit tu te permets de dire aux gens qu’ils ne peuvent pas vivre dans les grandes villes? »
« Aucun. Je me moque complètement de là où les gens vivent. Mais les gens qui vivent dans les grandes villes n’ont pas le droit de demander – en encore moins de voler – les ressources de tous les autres. »
« Ça te pose un problème si les citadins les achètent juste? »
« Acheter les ressources, ou les gens? » J’étais en train de penser à une phrase d’Henry Adams: « Nous avons un seul système,» a-t-il écrit, et dans « ce système la seule question est le prix auquel le prolétariat est acheté et vendu, le pain et le cirque. »41
Elle n’a pas ri à ma plaisanterie. Elle ne pensait pas que c’était drôle. Moi non plus, mais probablement pour une raison différente.
J’ai demandé: « Les acheter avec quoi? »
« Nous leur donnons de la nourriture, nous leur donnons de la culture. Ce n’est pas comme ça que ça fonctionne? »
Ah, j’ai pensé, elle suit la ligne de pensée de Mumford. J’ai demandé: « Et si les gens de la campagne n’aiment pas l’opéra, ou Oprah, d’ailleurs? »
« Ce n’est pas juste l’opéra. De la bonne nourriture, des livres, des idées, tout le bouillonnement culturel. »
« Et si les personnes de la campagne aime leur propre nourriture, leurs propres idées, leur propre culture? »
« Ils vont avoir besoin de protection. »
« Pour être protégés de qui? »
« Des bandes errantes de maraudeurs. Les bandits qui vont leur voler leur nourriture. »
« Et si les seuls voleurs sont les gens qui vivent dans les grandes villes? »
Elle hésita avant de parler: « Des biens manufacturés, alors? A cause des économies d’échelle, les gens dans les grandes villes peuvent importer des matières premières de la campagne, les transformer en objets que les gens peuvent utiliser et les leur vendre en retour. » Son premier diplôme était en Economie.
« Et si les gens dans les campagnes ne veulent pas non plus de biens manufacturés? »
« La médecine moderne alors. »
« Et s’ils n’en veulent pas? Je connais plein d’Indiens qui aujourd’hui refusent toute médecine occidentale. »
Elle a ri et dit, « donc nous allons dans des directions opposées. Tout le monde veut des Big Macs. »
J’ai secoué la tête, et plus ou moins ignoré sa plaisanterie, comme elle a ignoré la mienne, pour peut-être la même raison. « Les gens veulent ce genre de choses seulement une fois que leur propre culture ait été détruite. »
« Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de les détruire. Il vaut bien mieux les convaincre. La modernité, c’est bien. Le développement, c’est bien. La technologie, c’est bien. Le choix de consommer, c’est bien. Tu pense que ça sert à quoi, la publicité? »
Peut-être que Henry Adams et le satiriste romain Juvenal auraient dû mentionner la publicité avec le pain et le cirque. Et peut-être qu’ils auraient dû mentionner l’importance des définitions des dictionnaires pour garder les gens dans les rangs. J’ai maintenu mon cap: « Les cultures intactes ouvrent généralement grand leur porte aux biens de consommation seulement si ceux-ci arrivent à main armée. Sûr, ils pourraient ramasser et choisir, mais ce n’est pas assez pour contre-balancer la perte de leurs ressources. Pense à ce qu’ont fait l’ALENA ou le GATT aux pauvres du Tiers-Monde, ou aux EU. Pense à ce qu’a fait Perry au Japon, ou à la guerre de l’opium, ou – »
Elle m’a coupé: « Je vois où tu veux en venir. » Elle a réfléchi un moment. « Au lieu d’articles manufacturés, donne-leur de l’argent. Un bon prix. Sans les arnaquer. Ils peuvent acheter ce qu’ils veulent avec tout leur argent, ou plutôt notre argent. »
« Et s’ils ne veulent pas d’argent? Et s’ils préfèrent avoir leurs ressources? Et s’ils ne veulent pas vendre parce qu’ils veulent ou ont besoin des ressources elles-mêmes? Et si toute leur façon de vivre est entièrement dépendante de ces ressources, et qu’ils préfèrent leur façon de vivre – par exemple, chasser et cueillir – à l’argent? Ou s’ils ne veulent pas vendre parce qu’ils ne croient pas en l’achat et la vente? Et s’ils ne croient pas aux transactions économiques? Ou même au-delà, et s’ils ne croient pas en l’idée même de ressources? »
Elle s’est retrouvée un peu ennuyée. « Ils ne croient pas aux arbres? Ils ne croient pas que les poissons existent? Qu’est-ce que tu penses qu’ils attrapent quand ils partent à la pêche? Qu’est-ce que tu es en train de me dire? »
« Ils croient aux arbres, et ils croient aux poissons. C’est juste que les arbres et les poissons ne sont pas des ressources. »
« Qu’est-ce que c’est, alors? »
« D’autres êtres. Tu peux tuer pour manger. Cela fait partie de la relation. Mais tu ne peux pas les vendre. »
Elle a compris. « Comme les Indiens pensaient. »
« Ils pensent encore, » ai-je dis. « De nombreux Indiens traditionnels. Et les grandes villes sont devenues si grandes maintenant – la mentalité citadine a grandi pour inclure toute la culture de la consommation – que les gens dans les campagnes ne peuvent certainement pas tuer assez pour nourrir la ville sans abîmer leur propre terre. Ils ne le pourraient jamais, par définition. Ce qui nous ramène à la question: Et s’ils ne veulent pas vendre? Les gens des villes ont-ils le droit, quand même, de prendre leurs ressources? »
« Comment ils font pour manger, autrement? »
Nous entendîmes encore le vent dehors, et la pluie commença à éclabousser la vitre. La pluie arrive souvent à l’horizontal ici à Crescent City, ou Tu’nes.
Elle a dit: « Si j’étais à la tête d’une grande ville, et que mes habitants – mes habitants, quelle expression intéressante, comme si je les possédais – mourraient de faim, , je prendrais la nourriture par la force. »
Plus de vent, plus de pluie. J’ai dis: « Et si tu as besoin d’esclaves pour faire marcher tes industries? Tu les prendrais aussi? Et si tu as besoin non pas seulement de nourriture et d’esclaves, mais si le pétrole est le sang de toute ton économie, et le métal ses os? Et si tu as besoin de tout ce qui vit sous le soleil? Vas-tu tout prendre? »
« Si j’en ai besoin – »
Je l’ai coupée: « Ou considères que tu en as besoin… »
Ca ne semblait pas la déranger. « Oui, » a-elle dit songeuse. Je pouvais voir qu’elle était en train de changer d’avis. Nous sommes restés silencieux un moment, puis elle a dit: « Et il y a la terre. Les grandes villes abîment la terre sur laquelle nous sommes. »
J’ai pensé aux chaussées, à l’asphalte. L’acier. Les gratte-ciel. J’ai pensé à un chêne vieux de 500 ans que j’ai vu à NYC, sur une pente dominant le fleuve Hudson. J’ai pensé à tout ce que cet arbre avait vu. D’abord un gland tombé dans une forêt ancienne – excepté que à l’époque il n’y avait aucune raison de qualifier cette forêt d’ancienne ou autrement que chez lui. Il a germé dans cette communauté variée, assisté à la course des poissons sautant dans l’eau du fleuve si puissamment qu’ils menaçaient d’emporter les filets de ceux qui voulaient les attraper, vu les communautés humaines vivant dans cette forêt, les humains qui ne les appauvrissaient pas, mais plutôt les renforçaient en étant réellement présent, par ce qu’ils rendaient à leur terre. Il a vu l’arrivée de la civilisation, la construction d’un village, d’une ville, d’une cité, d’une métropole, et de là, comme Mumford l’a présenté, la « Parasitopolis s’est transformée en Patholopolis, la cité des désordres mentaux, moraux, corporels, et finalement a terminé en Nécropolis, La Cité du Mort. »42 En cours de route, il a dit au revoir au bison des bois, au pigeon voyageur, au courlis Esquimau, au grand marronnier d’Amérique, aux blaireaux du Labrador qui longeaient les rives du Hudson. Il a dit au revoir (du moins pour maintenant) aux humains vivant de façon traditionnelle. Il a dit au revoir à ses arbres voisins, à la forêt où sa vie a commencée. Il a vu l’étalement de milliards de tonnes de ciment, l’érection de structures d’acier rigides et des édifices en briques au sommet en fil de rasoir.
Malheureusement, il n’a pas vécu assez longtemps pour voir tout ça tomber. L’arbre, je l’ai appris l’année dernière, n’est plus. Il a été coupé par un propriétaire inquiet que ses branches ne tombent sur son toit. Des environnementalistes – faisant ce qu’il nous semblait le mieux à faire – se sont réunis pour prier sur sa souche.
Je lui ai raconté cette histoire.
« Putain, » a-t-elle dit, « je capte. » Elle a secoué la tête. Des cheveux châtain pâle sont tombés pour couvrir un oeil. Elle a fait la moue, comme souvent elle fait quand elle réfléchit. Elle a dit finalement, « Merde. » Ensuite elle a souri juste légèrement, bien que je pourrais dire à ses yeux qu’elle était fatiguée. Elle a dit tout à coup, « Tu sais, si nous allons causer tous ces dégâts, le moins qu’on puisse faire est de dire la vérité. »
Traduction: derrickjensenfr.blogspot.ca
ndlt Derrick Jensen venait de lire un article scientifique parlant de la réactivité des écosystèmes aux impacts de la pollution, que ceux-ci pouvaient endurer une situation pendant un certain temps, parfois longtemps, avant de s’effondrer sans même un signe avant-coureur.
41 Cité par Vidal Gore, The Decline and fall of the America Empire, Odonian Press, Berkeley, 1995, p.19.
42 Mumford, Pentagon, gravure 24.